Depuis quand faut-il du courage pour penser librement?
Le 12 septembre 2024, dans une salle du Club suisse de la presse à Genève, un homme autrefois acclamé, aujourd’hui marginalisé, s’avance devant un public silencieux.
Le Professeur Didier Raoult.
Autour de lui, des chaises vides. Les médias, eux, ont préféré boycotter. Ce simple décor suffit à poser le diagnostic: la liberté d’expression scientifique n’est plus un droit, c’est une transgression.
Raoult n’est pas seulement venu parler de virus. Il est venu parler de vérité.
De cette vérité qu’on bâillonne sous prétexte de protéger « la science », alors qu’on ne protège en réalité qu’un système devenu dogmatique. L’homme qui, hier encore, incarnait la recherche française ose rappeler une évidence oubliée : « la science n’est pas un credo, c’est une méthode« .
Et cette méthode commence toujours par le doute.
Mais le doute, aujourd’hui, est puni.
Questionner le confinement, c’est être complotiste. Interroger l’efficacité d’un vaccin, c’est être dangereux. Évoquer les conflits d’intérêts, c’est être “anti-science”.
L’inversion est totale: les esprits libres deviennent suspects, les contradicteurs sont bannis, et les médias applaudissent la censure comme on acclame un progrès moral.
C’est précisément ce que dénonce Jean-Dominique Michel dans Autopsie d’un désastre, un livre clé pour comprendre comment, sous couvert de santé publique, on a confisqué le débat, réduit la pensée au silence et transformé la science en instrument politique.
Et si le plus grand scandale du Covid n’était pas sanitaire, mais intellectuel?
Le courage de la parole libre face au conformisme médical
Genève, Club suisse de la presse. La salle n’est pas pleine, mais l’air est chargé d’électricité. Des journalistes manquent à l’appel, des avertissements officiels s’affichent, et pourtant la parole circule. Didier Raoult parle d’observation clinique, de patients réels, de signes que seule la proximité du soin permet de voir.
Ce que la modélisation promet, la clinique le vérifie ou l’infirme. Ici, la science se pratique au chevet, pas dans l’abstraction.
Ce contraste frappe. D’un côté, une médecine vivante qui doute, regarde, ajuste. De l’autre, une bureaucratie sanitaire qui décrète, normalise, sanctionne. Lorsque le doute devient suspect, la pensée se fige.
Et une science figée n’éclaire plus, elle impose.
C’est là que naît la véritable fracture: la liberté d’expression scientifique recule, la conformité progresse, et le débat se réduit à des anathèmes.
Regardez la conférence pour sentir cette tension, sans intermédiaire, sans filtre.
Laissez-vous faire votre propre idée, à partir des faits, des mots, des nuances.
À ce moment, une question simple s’impose: comment en est-on arrivé là?
Qui a serré l’étau, pourquoi, comment?
Pour relier les points, l’enquête de Jean-Dominique Michel offre une boussole précieuse.
Elle remonte le fil des décisions, des récits officiels, des mécanismes d’influence, et montre comment une crise sanitaire s’est doublée d’une crise de la raison publique.
Poursuivez l’exploration avec La fabrication du désastre: le livre qui répond précisément à ces questions, sans détour, avec des faits vérifiables.
Quand la science devient une religion
Il fut un temps où la science avançait par le doute. Aujourd’hui, elle avance par décret. On ne démontre plus, on décrète. On ne discute plus, on interdit. Les chercheurs indépendants sont traités comme des hérétiques et les laboratoires pharmaceutiques comme des temples de vérité.
C’est le nouveau clergé de la modernité, celui des “experts” autorisés à penser pour nous.
Didier Raoult le dit sans détour: «La science n’est pas une foi, c’est une confrontation permanente avec le réel.»
Pourtant, dans cette ère d’hystérie sanitaire, le doute devient un blasphème et la prudence intellectuelle une faute morale.
On ne demande plus “qu’est-ce qui est vrai?”, mais “qui a le droit de parler?”.
Ce glissement insidieux transforme la recherche en croyance. L’opinion remplace la preuve, la peur remplace la raison. Et chaque voix dissidente, qu’elle parle de traitements alternatifs ou de terrain biologique, se voit aussitôt frappée d’anathème.
C’est précisément ce que révèle le livre La guerre contre l’ivermectine: comment un médicament aux effets connus depuis des décennies a soudain été diabolisé, non pour des raisons scientifiques, mais idéologiques. Cette lecture met en lumière un phénomène plus profond encore: la santé publique n’est plus un champ de recherche, c’est devenu un champ de bataille.
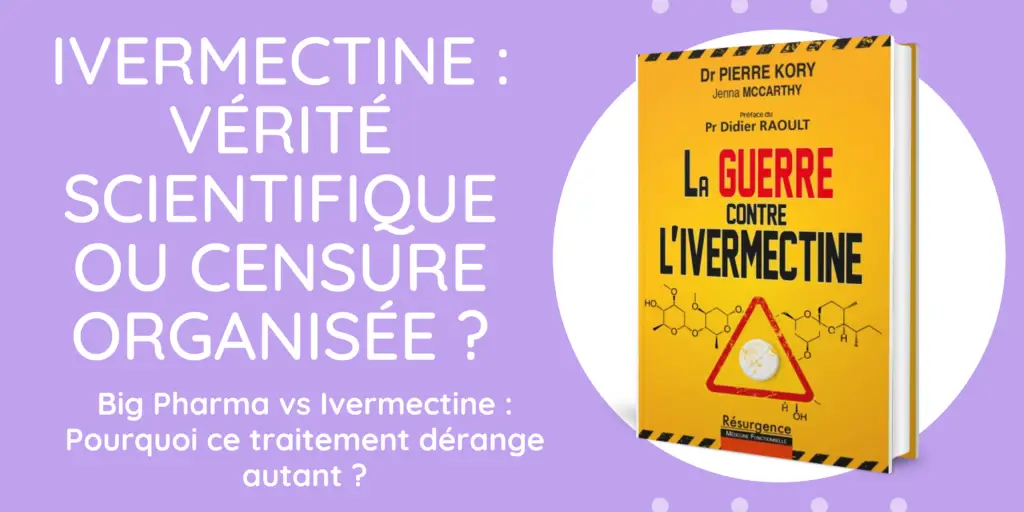
À mesure que cette “religion scientifique” impose son dogme, elle éloigne la médecine de sa mission première: soigner.
Et ce que la peur a gagné en obéissance, l’humanité l’a perdu en discernement.
Les racines profondes d’un système malade
Derrière la censure et la peur se cache une mécanique bien huilée. Les grandes institutions de santé, censées garantir la neutralité scientifique, se sont transformées en acteurs économiques aux intérêts immenses.
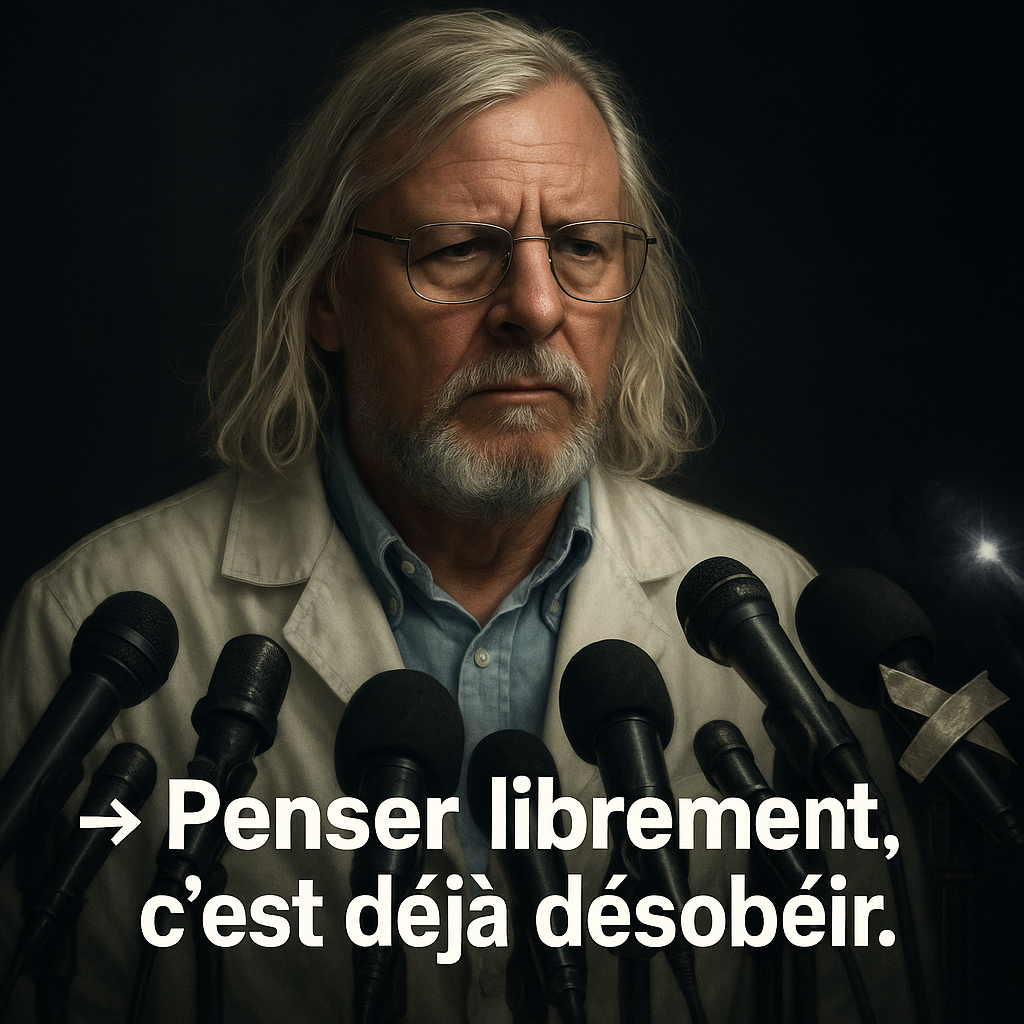
L’Organisation mondiale de la santé reçoit aujourd’hui une part majeure de son financement non pas des États, mais de fondations privées et de groupes industriels.
Big Pharma, quant à lui, cumule des centaines de condamnations pénales pour fraude ou manipulation de données, sans jamais être réellement inquiété.
Cette capture de la santé par l’argent crée une illusion d’autorité. Des revues médicales autrefois prestigieuses publient désormais des études financées, orientées, parfois falsifiées.
La science n’est plus un bien commun, mais une propriété sous licence.
Le médecin devient simple exécutant, le chercheur un communicant, et le citoyen un consommateur obéissant.
C’est ce que révèle avec précision Didier Raoult lorsqu’il évoque la dépendance des politiques sanitaires aux lobbies pharmaceutiques et médiatiques.
Son constat rejoint celui de nombreux auteurs publiés aux Éditions marco pietteur: la santé publique a été dévoyée par des logiques de profit, de contrôle et de peur.
Ce constat fait écho au travail de Jean-Dominique Michel dans La fabrication du désastre et prolonge la réflexion entamée par La guerre contre l’ivermectine. Ces ouvrages forment un triptyque de lucidité sur la manipulation globale qui a rendu possible cette inversion des valeurs: la vérité réduite au silence, et le mensonge élevé au rang d’expertise.
Lorsque la science devient un instrument de pouvoir, l’éthique s’effondre.
Et lorsque la peur devient un modèle économique, il ne reste qu’une issue: reprendre le droit de penser par soi-même.
Vers une renaissance de la science libre
Malgré le tumulte, quelque chose renaît. Dans le silence des chercheurs censurés, dans la fatigue des citoyens trompés, un souffle nouveau se lève: celui du discernement. Le Covid aura été une épreuve, mais aussi une initiation. Beaucoup ont compris que la vérité scientifique n’est pas donnée par décret, qu’elle ne se décrète pas depuis un plateau télé ni un ministère, mais qu’elle se cherche, s’expérimente, se vit.
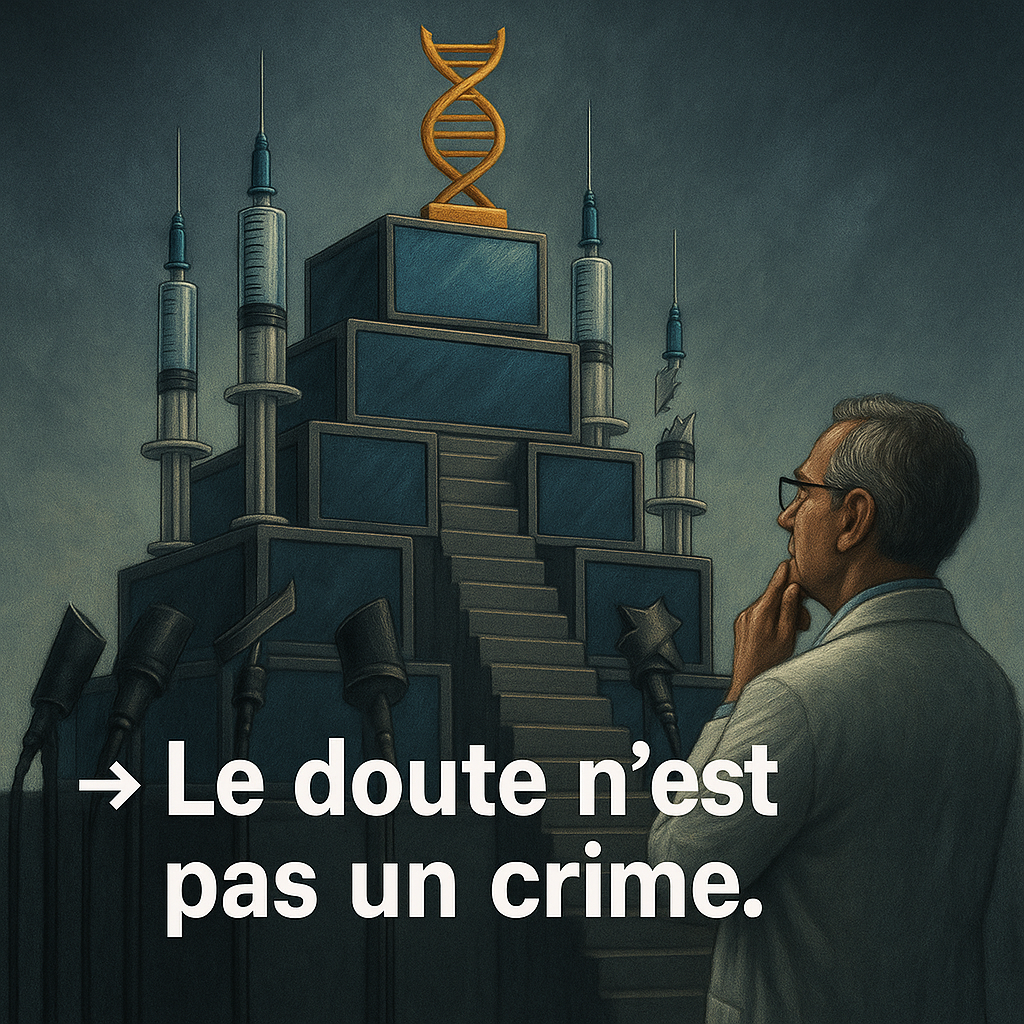
Didier Raoult, en refusant le confort du consensus, nous rappelle une leçon ancienne: la science authentique est fille du doute et sœur du courage. Elle n’appartient à personne, pas plus aux experts qu’aux institutions, mais à tous ceux qui osent regarder le réel sans peur. C’est cette attitude d’esprit, libre et lucide, qui réconcilie la médecine avec l’humanité.
Ce renouveau passe par une réappropriation collective du savoir, par un retour au terrain, à l’observation, à la sagesse de la vie. Ce que nous avons perdu dans la frénésie des modèles et des algorithmes, nous pouvons le retrouver dans la simplicité d’un regard honnête, d’une main qui soigne, d’un esprit qui interroge.
C’est aussi le message des ouvrages publiés aux Éditions marco pietteur: éveiller, informer, libérer.
En lisant Autopsie d’un désastre, La fabrication du désastre ou La guerre contre l’ivermectine, chacun retrouve le fil d’une vérité qui nous avait échappé, celui de la conscience.
Ces livres ne sont pas des pamphlets, ce sont des actes de résistance.
La liberté d’expression scientifique n’est pas une option, c’est une condition de survie pour l’humanité.
Car lorsque la peur se tait, la vérité peut enfin respirer.
Et vous, qu’en pensez-vous?
Pensez-vous que la science a perdu son indépendance?
Avez-vous ressenti, vous aussi, cette confiscation du débat?
Partagez votre réflexion en commentaire: vos mots nourrissent le dialogue que d’autres veulent étouffer.




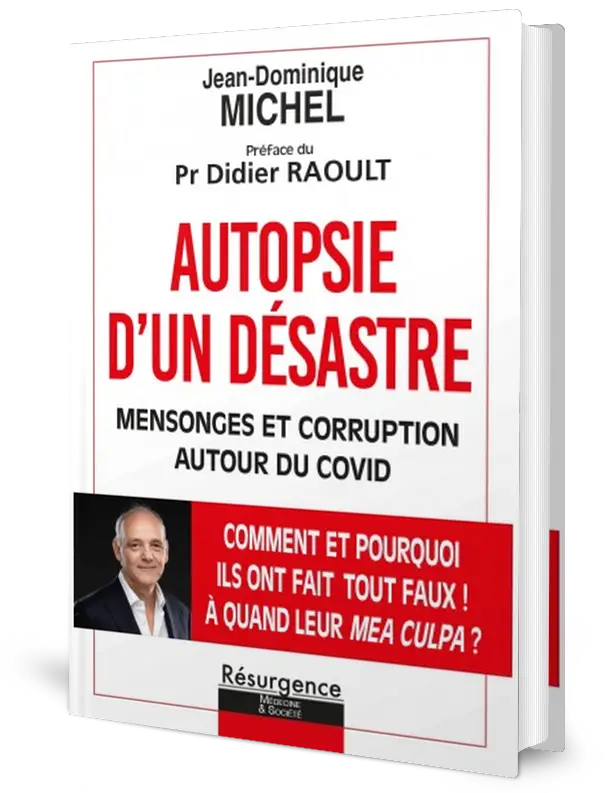
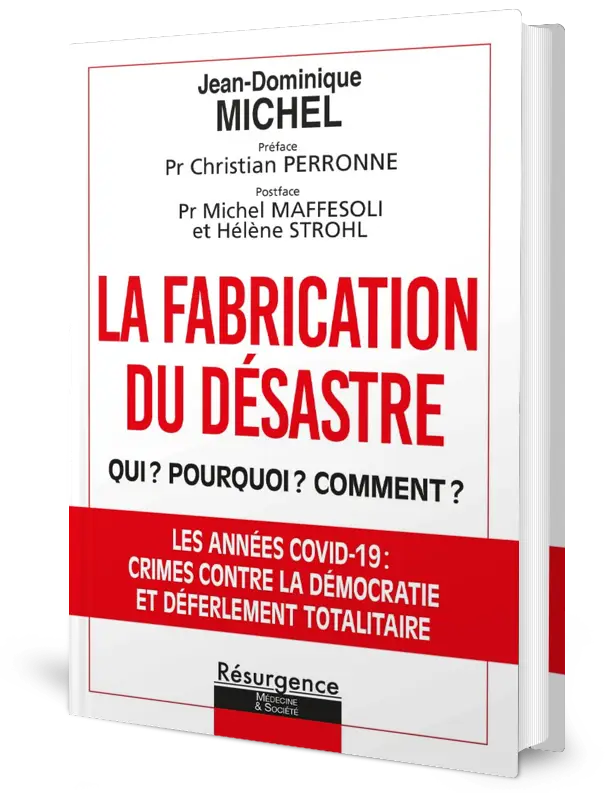

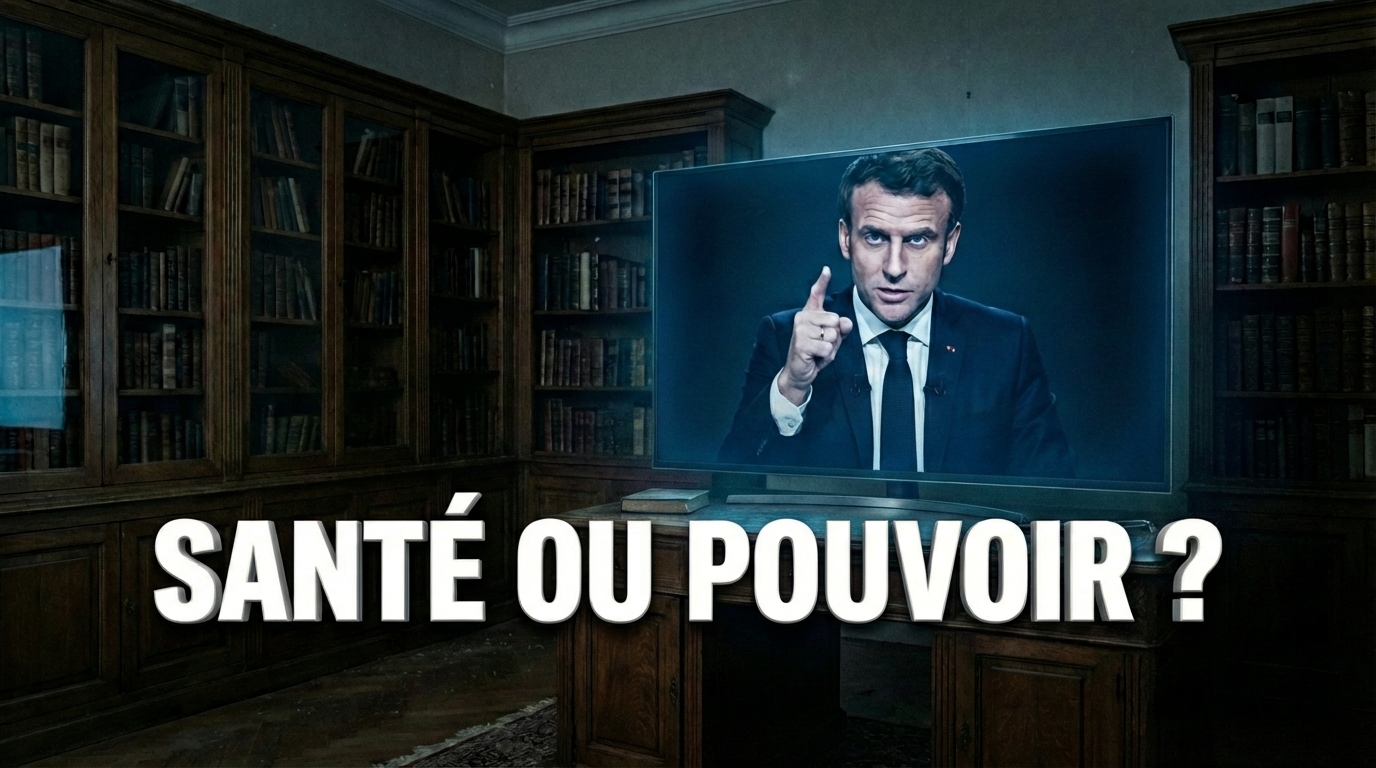
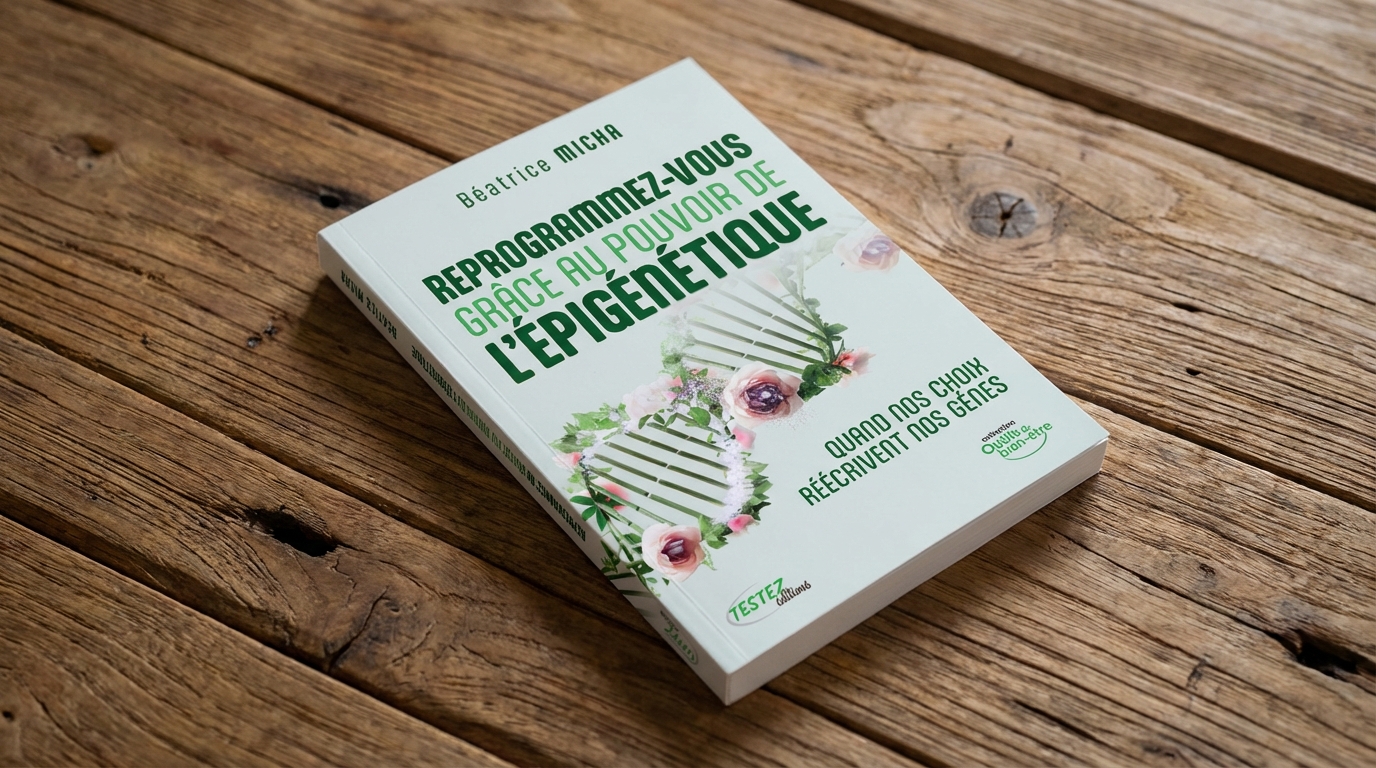

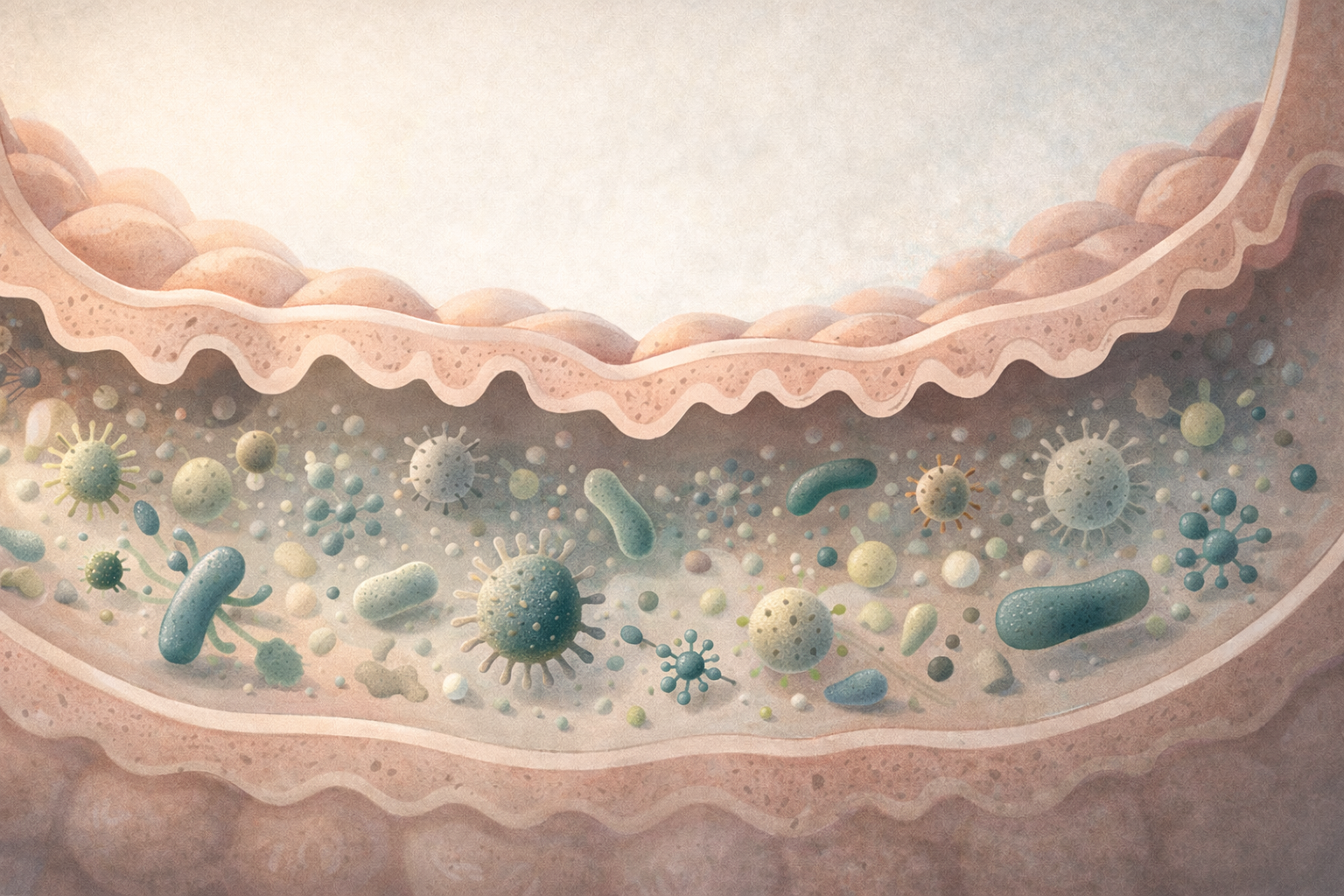
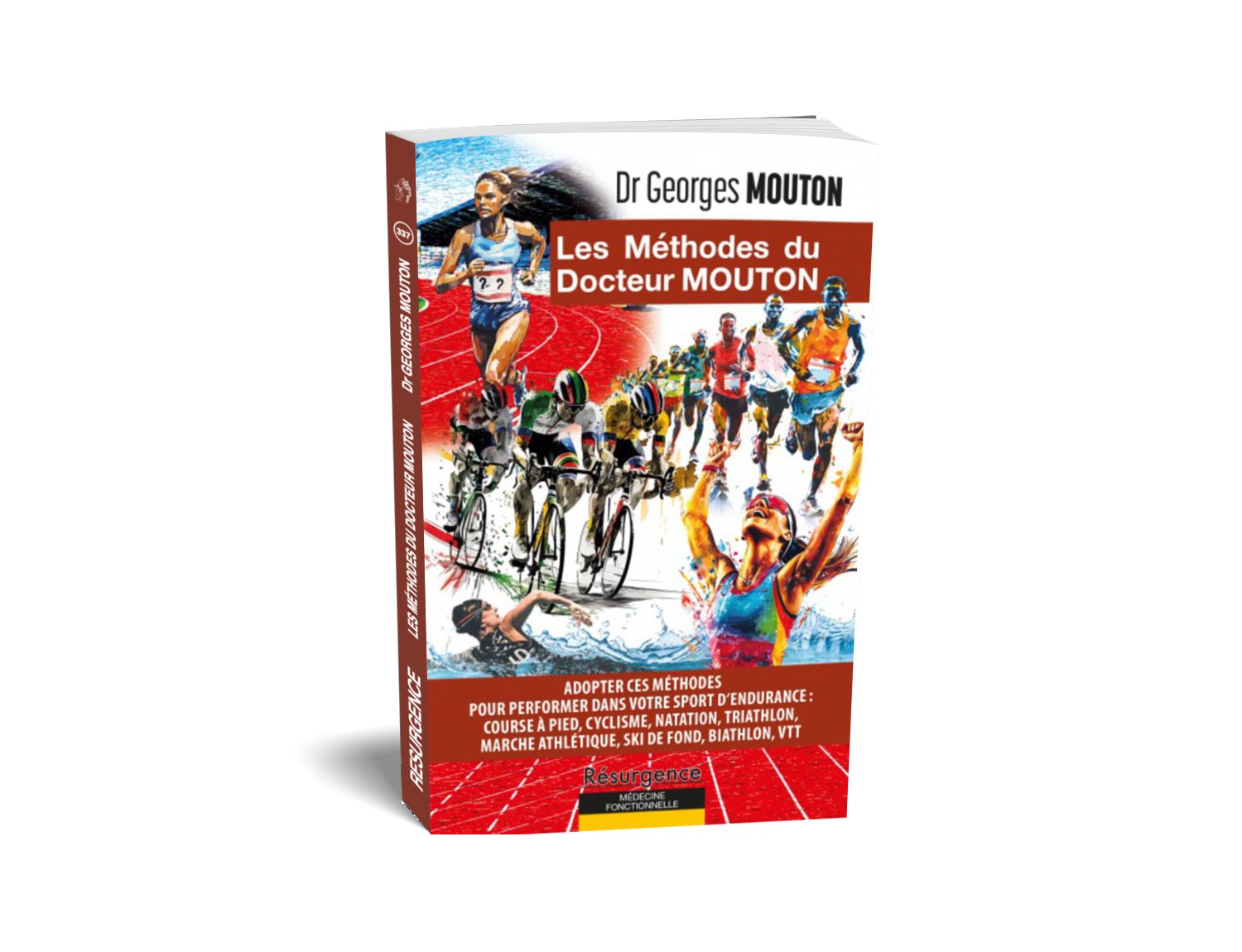
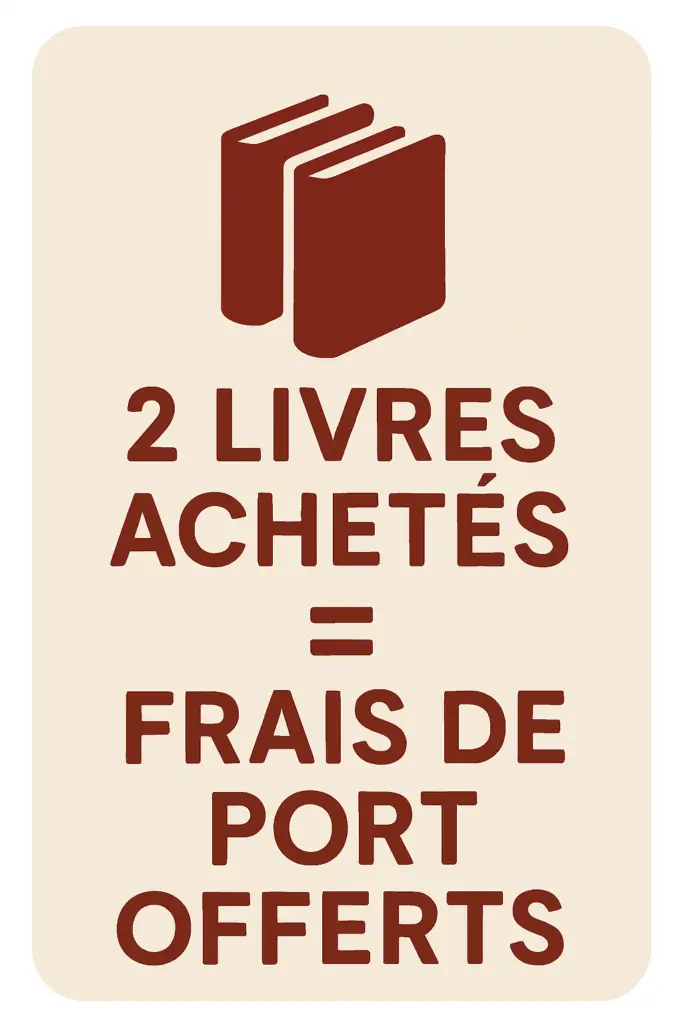

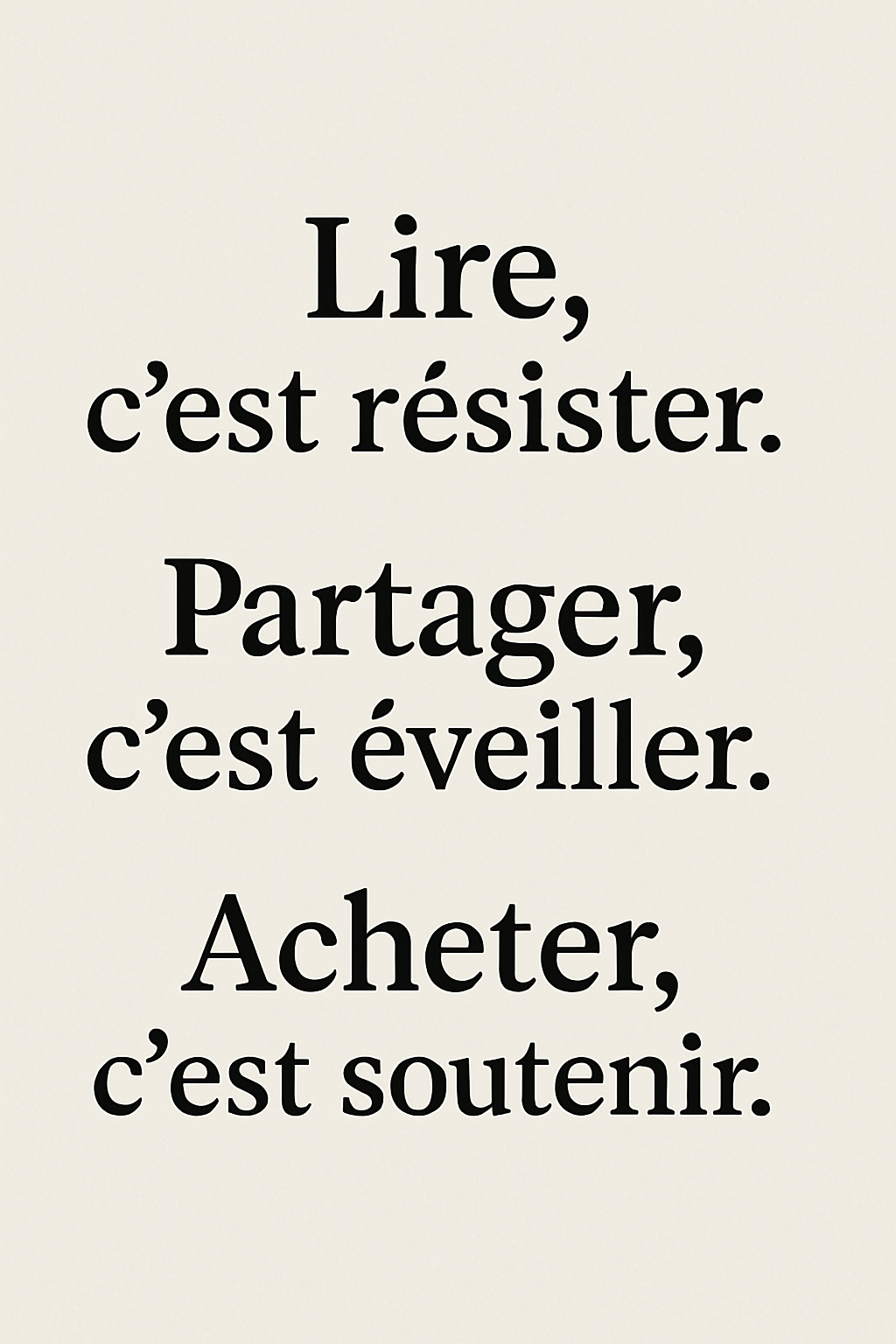

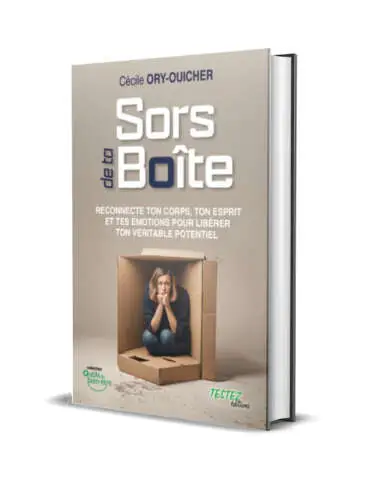
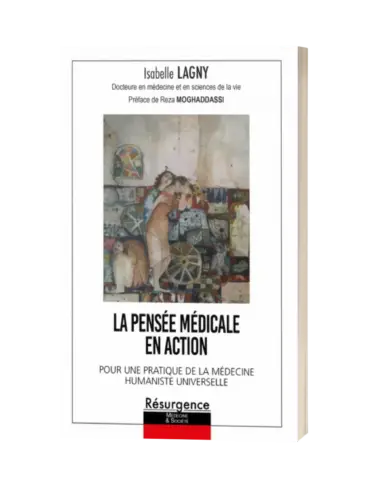
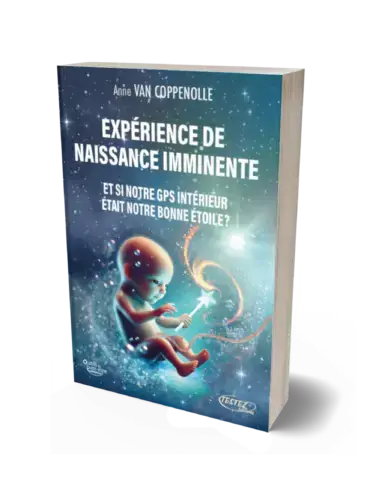

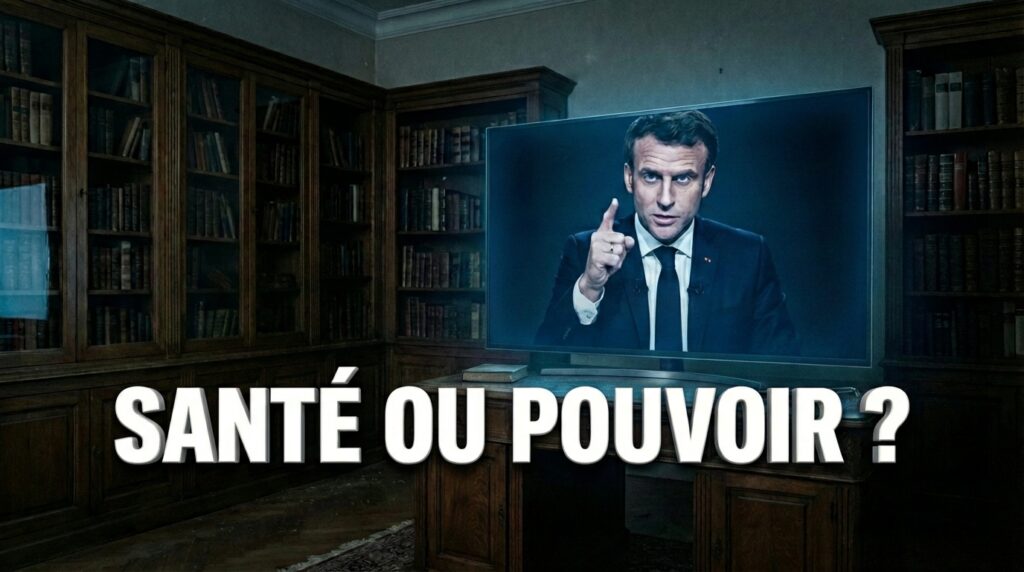
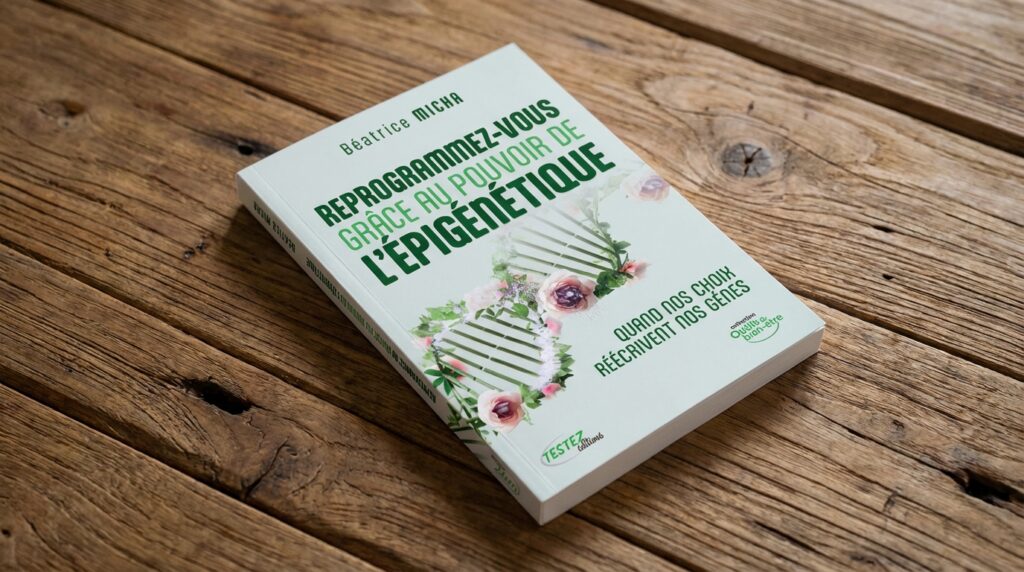

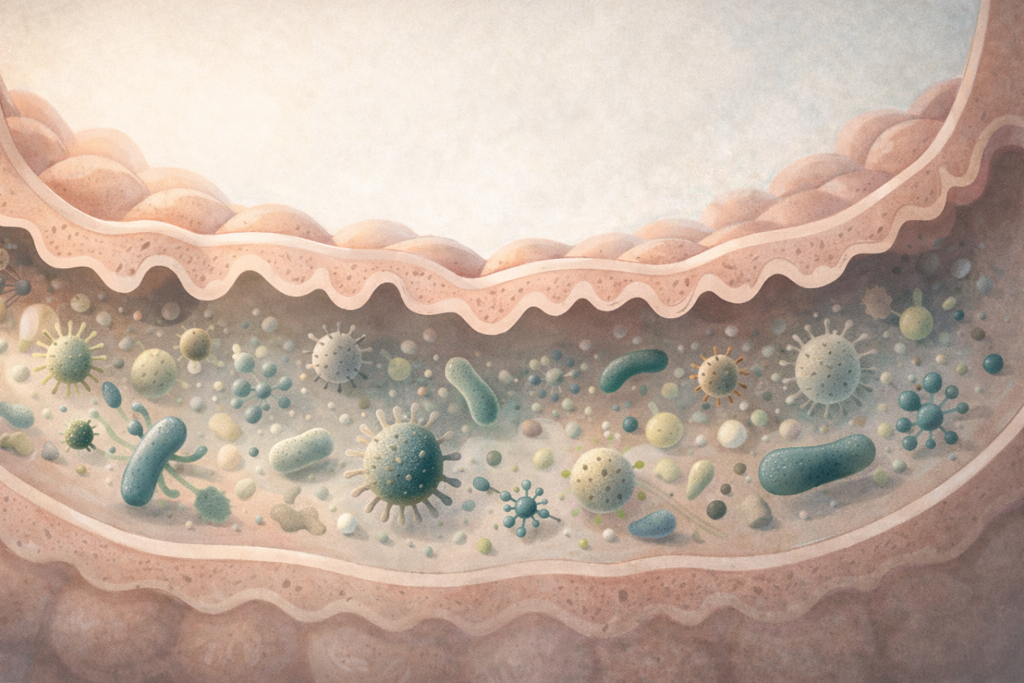
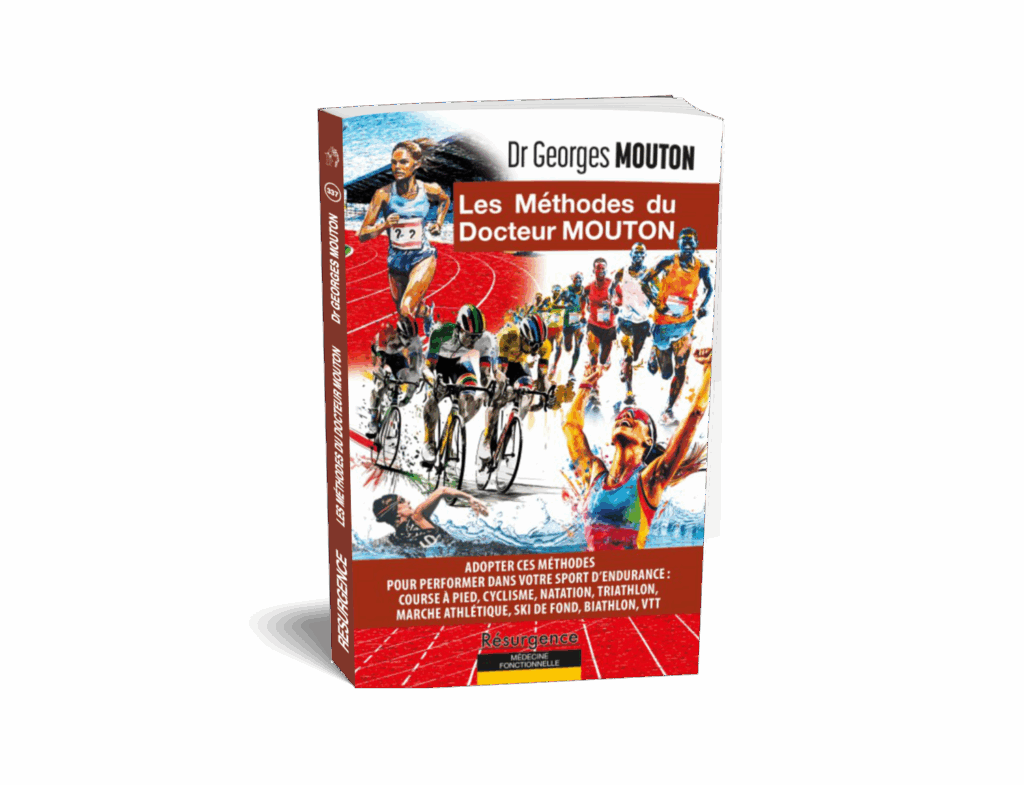
Un commentaire
Je vous rejoins. Je travaille avec des handicapés et j’ai bien peur que l’on va nous inposerla vaccination de la grippe. Je voudrai y échapper. Comment faire ? Il me reste quelques années avant la retraite….
Ca me désespère que les gens soient si peu intéressé par leur propre santé.
Mais on tombé ds le chaudron petit, car nos parents avaient été déjà bien endoctriné. Ils faisaient confiance à leur médecin. Lui seul avait la science infuse