Peu de patients s’interrogent vraiment sur les médicaments qu’ils avalent chaque jour. Encore moins nombreux sont ceux qui osent remettre en question leur efficacité ou leur innocuité.
Pourtant, certains traitements présentés comme anodins – comme le paracétamol, les antidépresseurs ou certains vaccins – soulèvent des interrogations de plus en plus sérieuses.
Le docteur Vincent Reliquet, médecin généraliste pendant plus de vingt-cinq ans, est l’un des rares professionnels de santé à avoir osé franchir la ligne rouge : parler publiquement des dangers des médicaments les plus répandus.
Et surtout, en apporter la démonstration rigoureuse, références à l’appui.
À travers sa trilogie intitulée Chroniques de médecine contestataire (voir liens ci-dessous), il décortique des décennies d’habitudes médicales, de prescriptions automatiques, et de protocoles standardisés souvent appliqués sans discernement.
Son objectif n’est pas de faire peur, mais de rétablir un principe fondamental : le droit de chaque citoyen à une information médicale claire, complète et non biaisée.
Ses ouvrages sont un appel à la vigilance. À la lucidité.
Et, surtout, à la responsabilité individuelle.
Ce n’est pas un hasard si ses livres rencontrent un succès grandissant auprès d’un public de plus en plus critique vis-à-vis du discours officiel.
Ni si ses prises de position lui ont valu une radiation de l’Ordre des médecins et plusieurs poursuites judiciaires.
Car dénoncer les dangers des médicaments, même avec preuves à l’appui, dérange puissamment les structures en place.
En exposant les effets secondaires sous-estimés, les failles des essais cliniques, ou les influences de l’industrie pharmaceutique, le Dr Reliquet ne fait pas que témoigner : il remet en cause un modèle de santé tout entier.
Mais qu’a-t-il réellement découvert ?
Pourquoi considère-t-il certains traitements comme plus dangereux que bénéfiques ?
Et surtout, pourquoi tant de voix médicales refusent encore d’ouvrir le débat ?
C’est ce que nous allons explorer dans les prochaines sections (et dans son interview), à travers quelques exemples emblématiques issus de ses enquêtes médicales : le paracétamol, les antidépresseurs, les vaccins, et la chimiothérapie.
Quand les médicaments font plus de mal que de bien : cas concrets
Le Dr Reliquet ne se contente pas de déclarations provocatrices. Il s’appuie sur des décennies de lecture scientifique, d’observation clinique et d’analyse rigoureuse pour démontrer pourquoi certains traitements, pourtant largement prescrits, peuvent être contre-productifs.
Son approche repose sur un constat simple : dans la majorité des cas, les patients ne sont pas informés des véritables dangers des médicaments qu’ils consomment.
Le cas du paracétamol est emblématique.
Présenté depuis plus de 50 ans comme un antalgique et antipyrétique de premier recours, il est en réalité bien plus toxique qu’on ne le croit, notamment pour le foie.

Chez les femmes enceintes, les nourrissons ou les personnes souffrant de maladies virales, son utilisation peut entraîner de graves effets secondaires. Le Dr Reliquet évoque même un effet aggravant lors d’infections comme le Covid, à cause de l’impact du paracétamol sur la production de glutathion hépatique, une molécule essentielle à la détoxification.
Une étude publiée dans le Nature Reviews Endocrinology met justement en garde contre les risques potentiels du paracétamol pendant la grossesse, évoquant des impacts hormonaux sur le développement du fœtus [source].
Autre sujet sensible : les antidépresseurs.
Le discours médical dominant les présente comme une réponse efficace à la dépression, mais la réalité clinique est bien moins rassurante.
Le Dr Reliquet explique que plus de 70 % des patients ne répondent pas du tout au traitement. Et lorsque les effets sont perceptibles, ils le sont souvent au prix d’une dépendance difficile à gérer.
Pire encore, l’arrêt du traitement est fréquemment suivi d’un effet rebond plus violent, enfermant les patients dans un cercle de souffrance prolongée.
Il insiste sur le fait que le manque d’accompagnement psychologique réel aggrave la situation, et que la solution médicamenteuse est souvent utilisée comme une béquille émotionnelle de masse.
Concernant les vaccins, il s’attaque à des cas emblématiques : celui du vaccin contre la rage, et celui contre la diphtérie-tétanos.
Pour le premier, il démontre, documents historiques à l’appui, que Louis Pasteur n’était ni médecin ni l’inventeur du vaccin antirabique, mais un excellent stratège en communication.
Il évoque notamment l’affaire du petit Joseph Meister, présenté comme un miracle vaccinal, alors que les documents familiaux et médicaux laissent penser qu’il n’avait probablement même pas contracté la rage.
Sur la diphtérie, le Dr Reliquet insiste sur le fait qu’un traitement efficace existait dès les années 1940, rendant inutile une vaccination systématique et risquée. Pourtant, par intérêt national et industriel, le vaccin a été imposé dans le calendrier pédiatrique.
Enfin, l’un des chapitres les plus durs concerne la chimiothérapie.
Pour de nombreux cancers, elle reste la norme, mais avec des résultats globalement décevants hors cas très spécifiques (comme certaines leucémies ou les tumeurs des testicules).
Il cite des enquêtes révélant que la majorité des oncologues ne souhaiteraient pas eux-mêmes subir les protocoles qu’ils prescrivent. Les effets secondaires sont souvent lourds, les bénéfices sur la survie incertains, et les coûts exorbitants.
Reliquet pointe ici une logique économique bien plus qu’humanitaire : le business des médicaments anticancer prime trop souvent sur la logique médicale.
À travers ces exemples, le Dr Reliquet ne propose pas de tout rejeter, mais il appelle à une refonte complète de notre rapport aux traitements : penser d’abord en termes de bienfaits réels, de risques concrets, et de liberté thérapeutique.
Et si le vrai traitement, c’était la lucidité ?
Le problème n’est pas qu’un médicament ait des effets secondaires.
Le problème, c’est que le patient ne les connaisse pas.
C’est là que se situe la frontière entre la médecine éclairée et la médecine automatique.
Ce que le Dr Reliquet nous invite à faire à travers ses chroniques, c’est à redevenir des êtres pensants, des citoyens de leur santé.
Son discours ne rejette pas la science, il réclame le retour de l’intelligence clinique, du consentement libre et éclairé, et de la transparence.
Parce qu’un traitement qui soigne sur le papier, mais détruit dans les faits, n’est pas un progrès.
Et parce qu’une société qui punit ceux qui posent des questions légitimes sur les médicaments devient une société malade.
Aujourd’hui, la parole médicale indépendante est menacée.
Pourtant, c’est elle qui nous aide à prendre du recul, à faire des choix informés, à comprendre que la santé ne se résume pas à avaler des comprimés.
C’est dans cet esprit que Jean-Pierre Reliquet a écrit ses trois tomes.
Pour documenter, dénoncer, et surtout éveiller.
📺 À regarder : Interview exclusive avec le Dr Reliquet
Voici l’entretien complet dans lequel le Dr Reliquet revient sur les révélations de son tome 2. Un témoignage sans langue de bois, à voir absolument.
👉 Regardez la vidéo:
📚 À lire : Chroniques de médecine contestataire, tomes 1, 2 et 3
Si vous voulez comprendre ce que cache vraiment l’ordonnance que vous tenez en main, lisez les Chroniques de médecine contestataire.
Un médecin vous y parle sans filtre. Il ne vous donne pas des ordres, il vous rend votre pouvoir.
👉 Commandez les tomes 1, 2 et 3 dès maintenant sur le site des Éditions marco pietteur:
Et vous, avez-vous déjà douté d’un traitement prescrit ?
Pensez-vous que les dangers de certains médicaments sont sous-estimés ?
💬 Partagez votre avis ou votre expérience en commentaire : votre témoignage peut éclairer d’autres lecteurs.




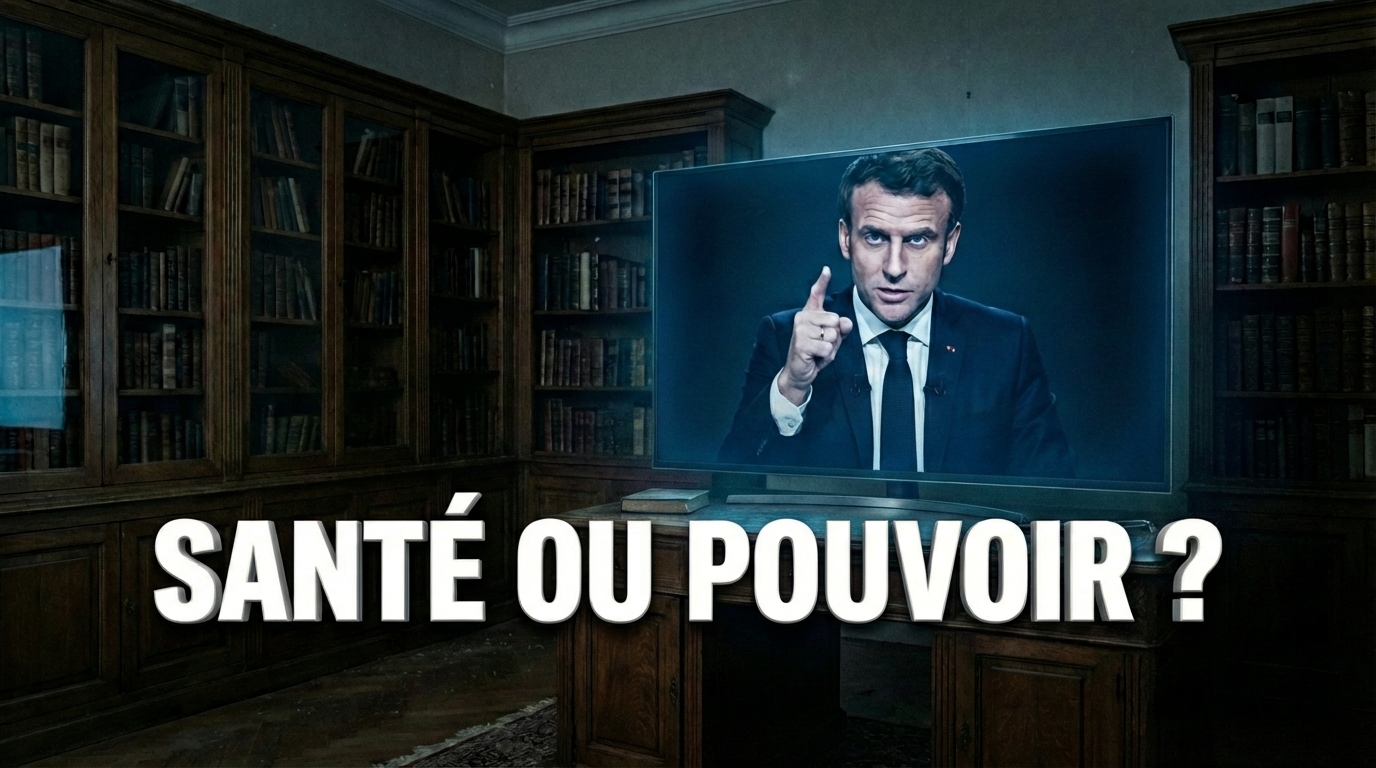
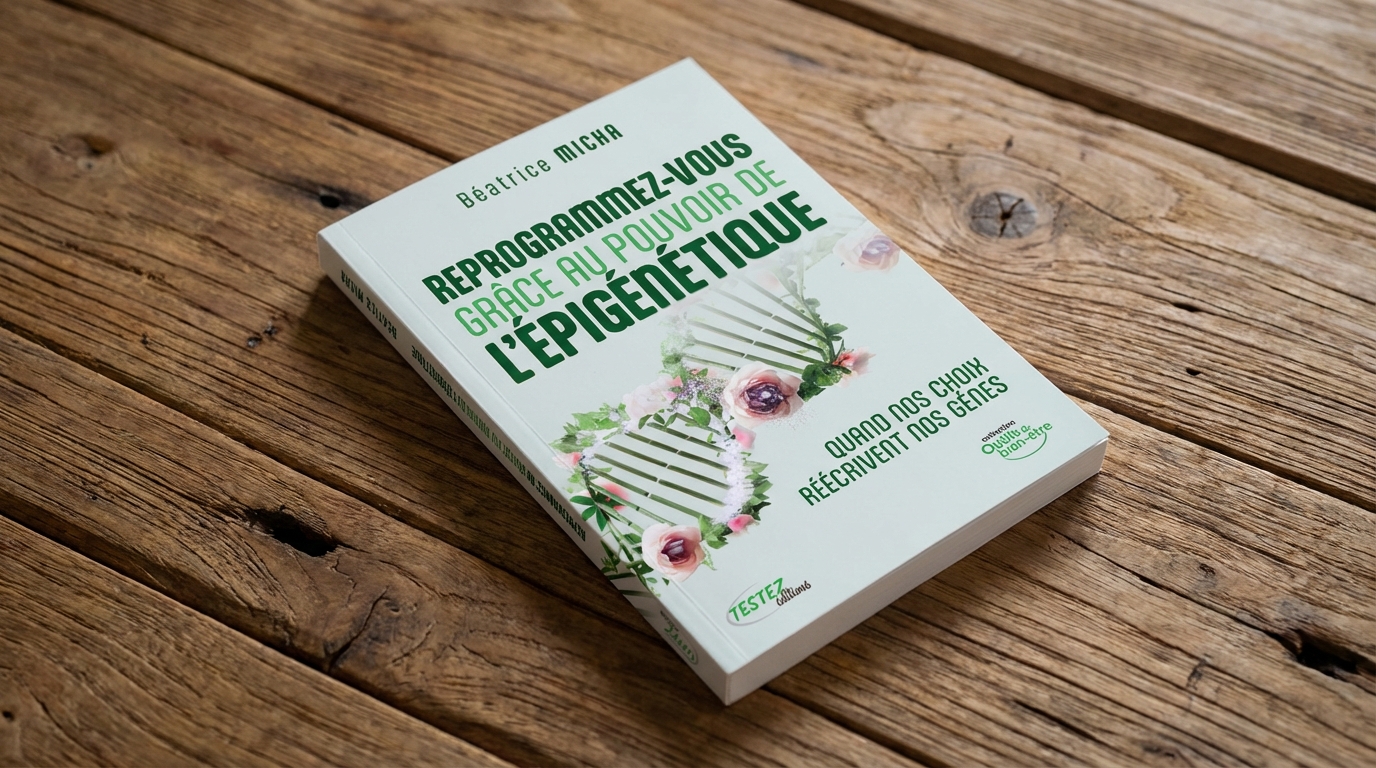

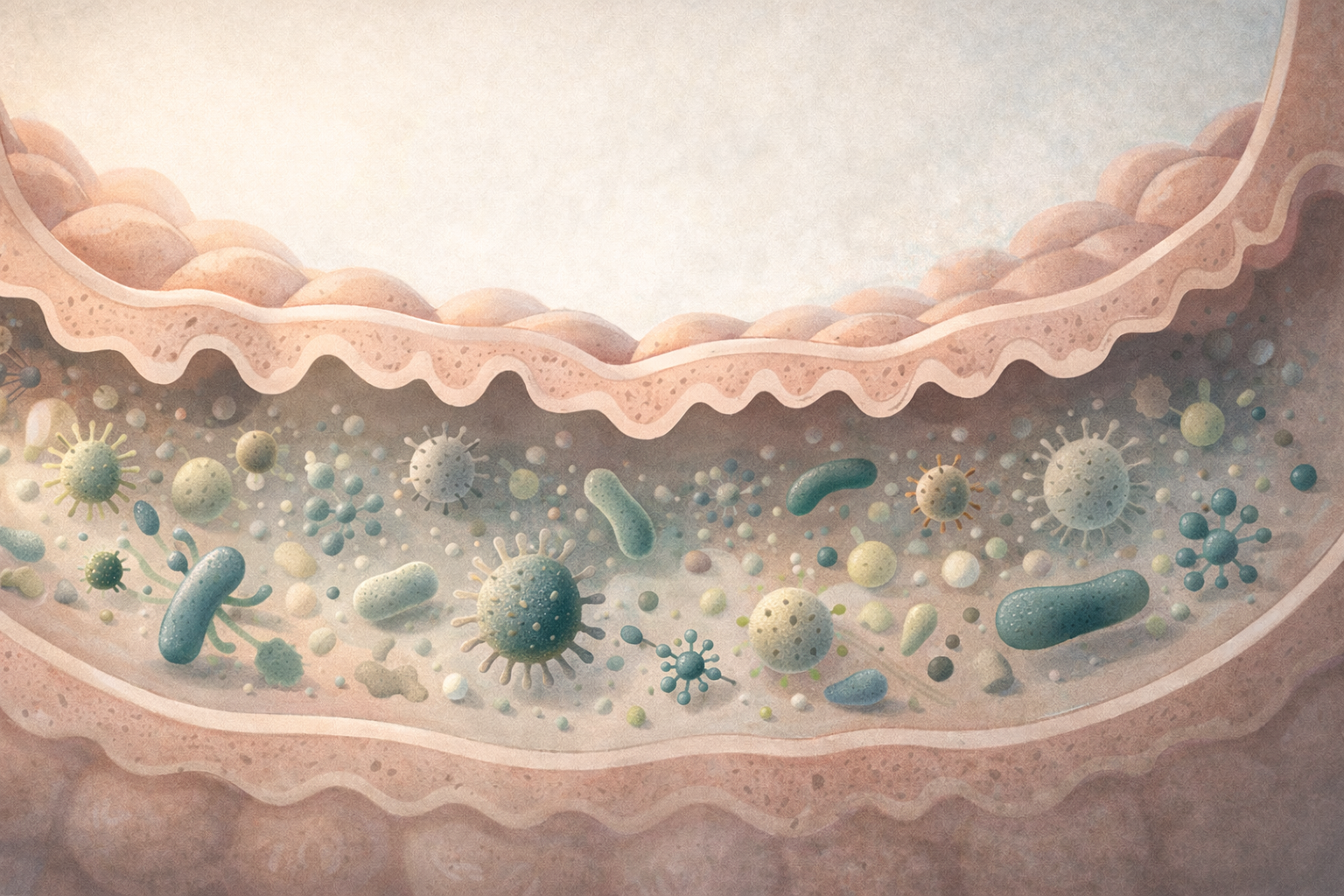
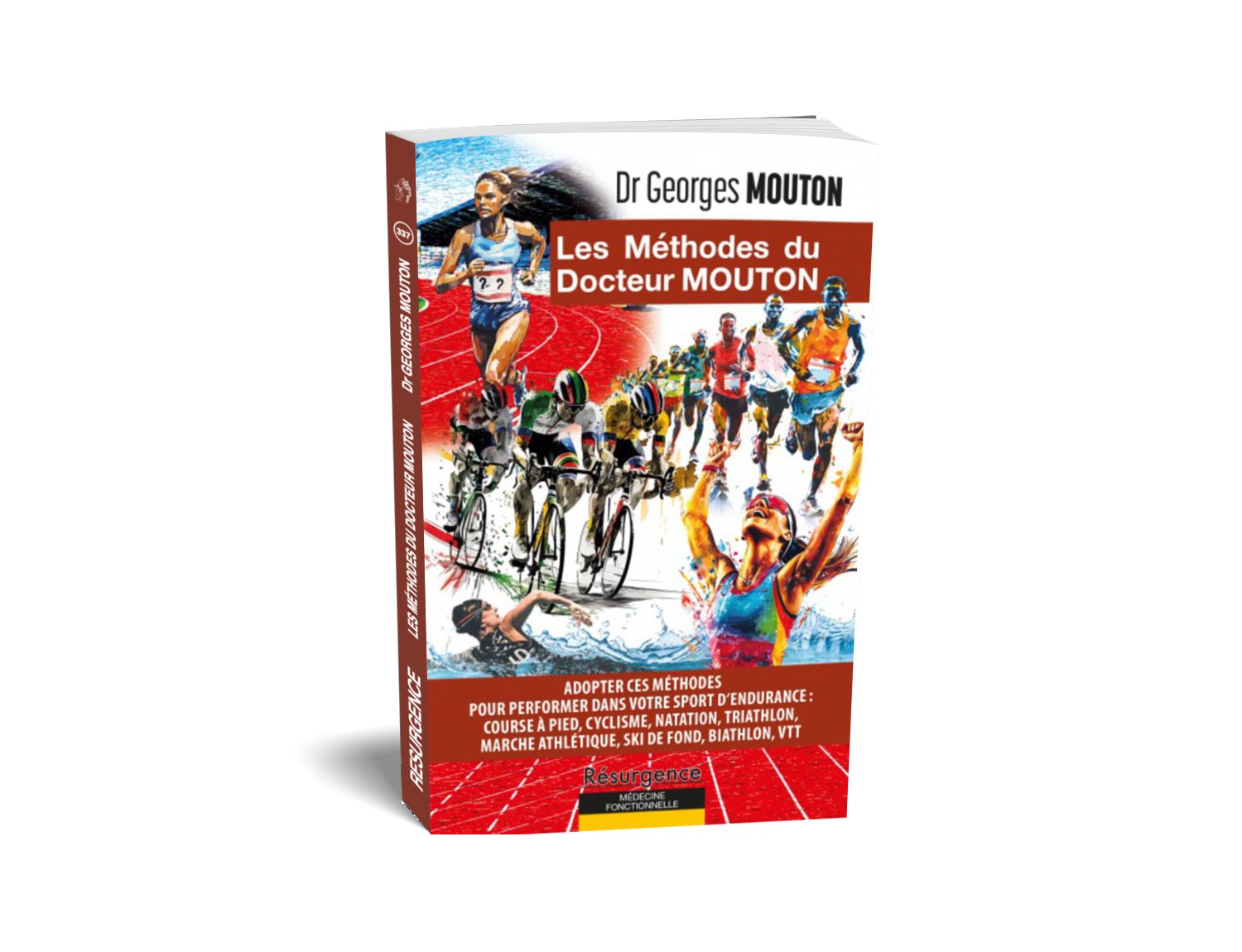

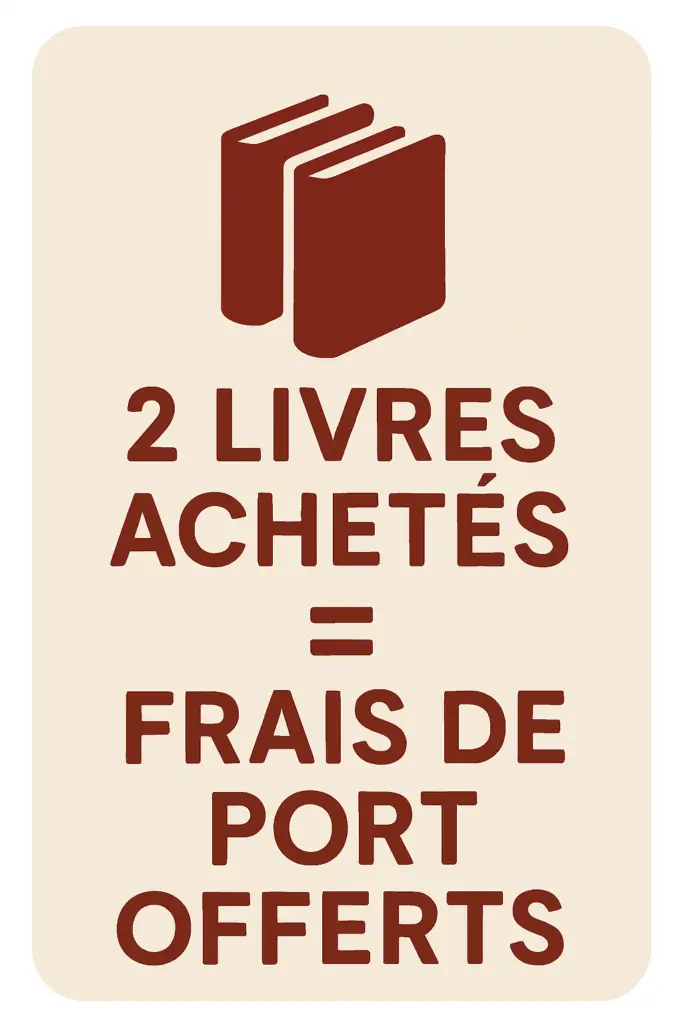

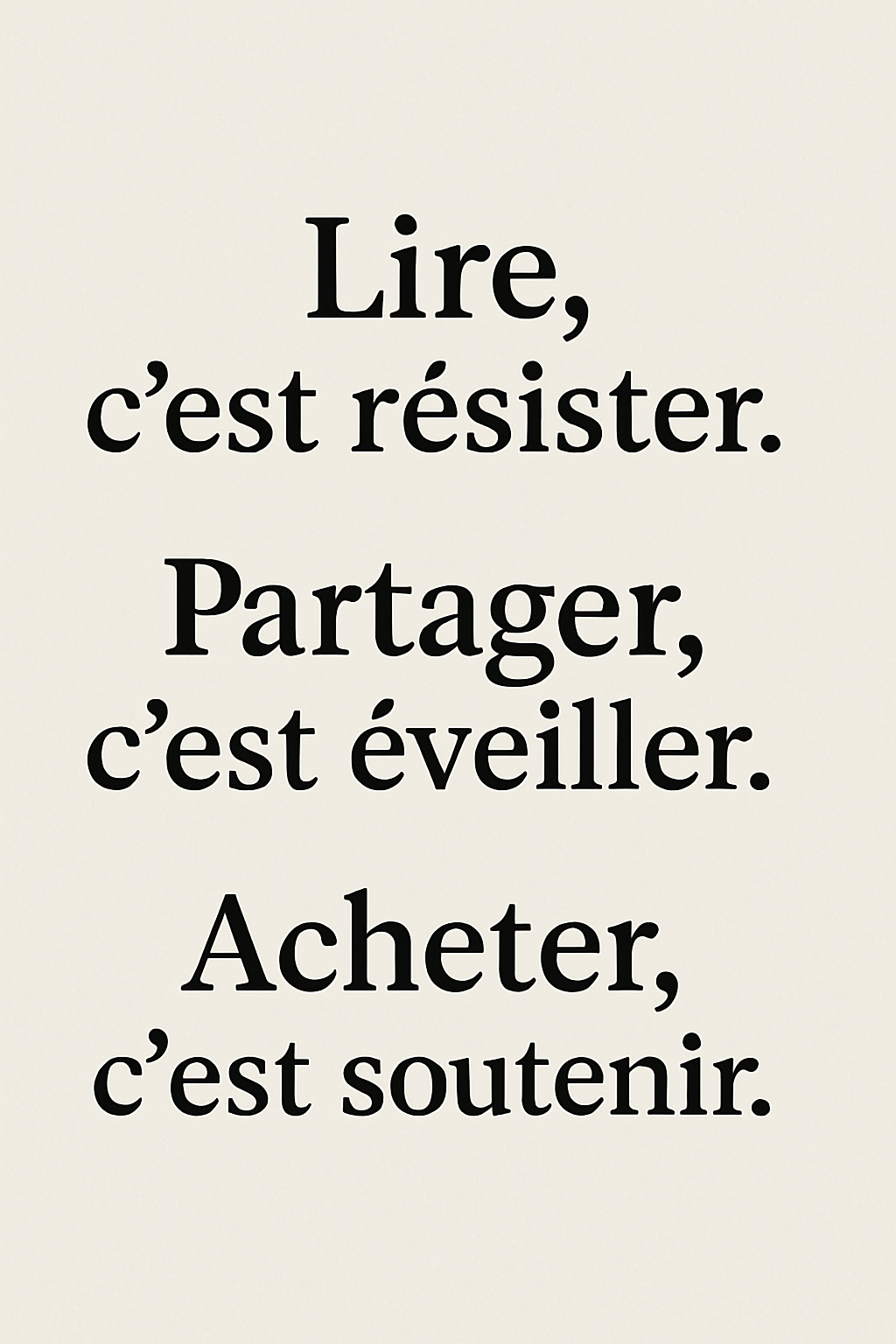

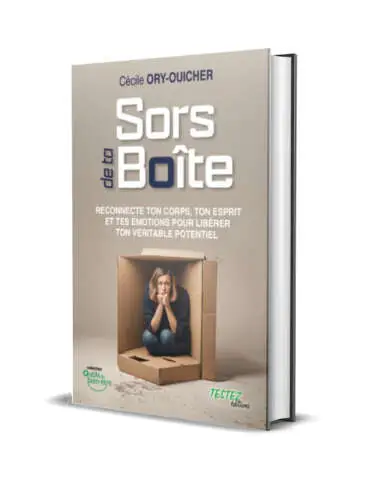
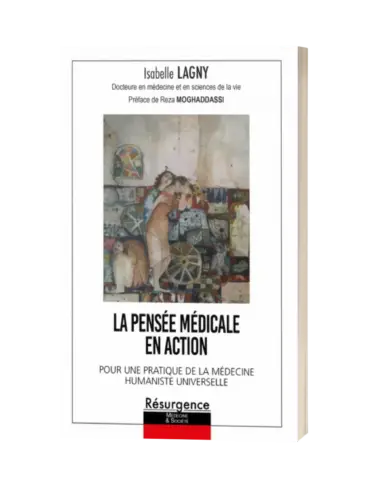
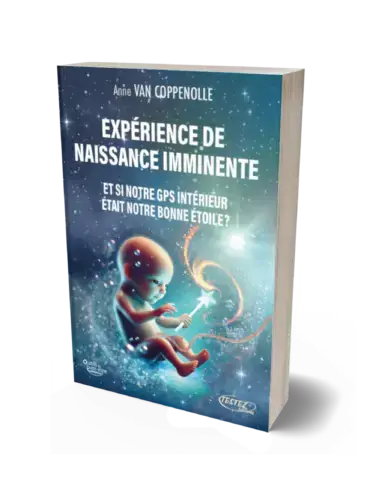
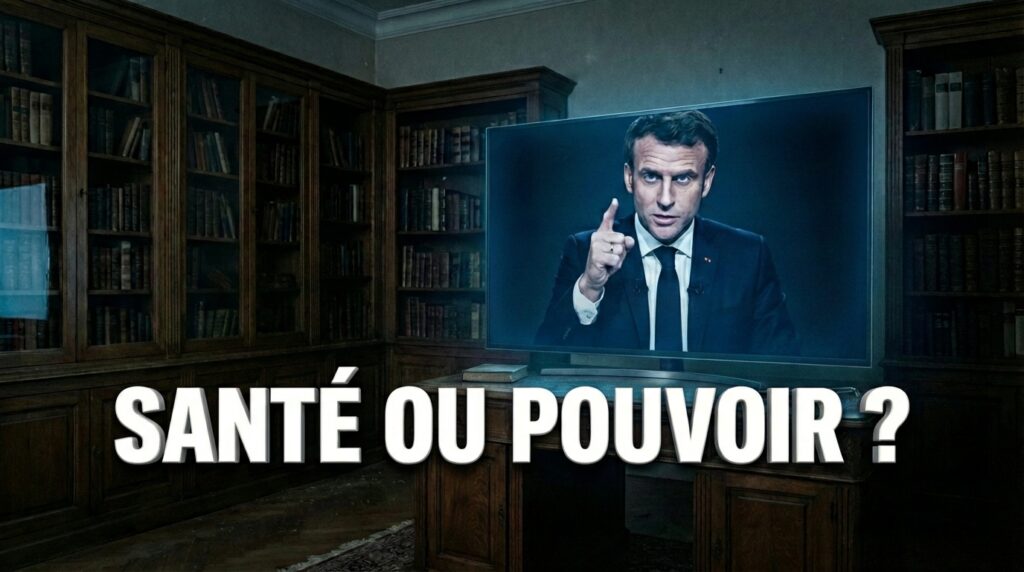
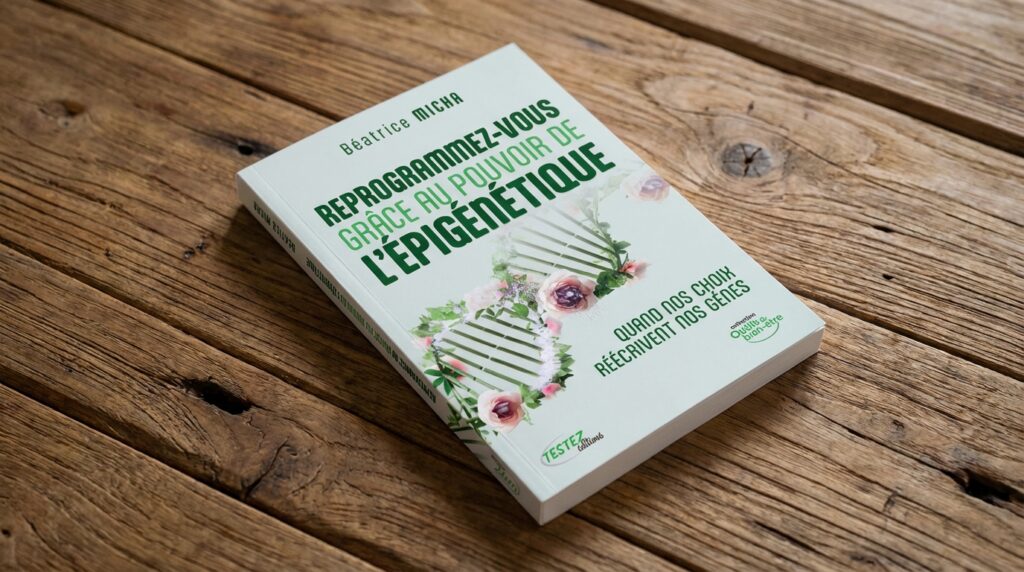

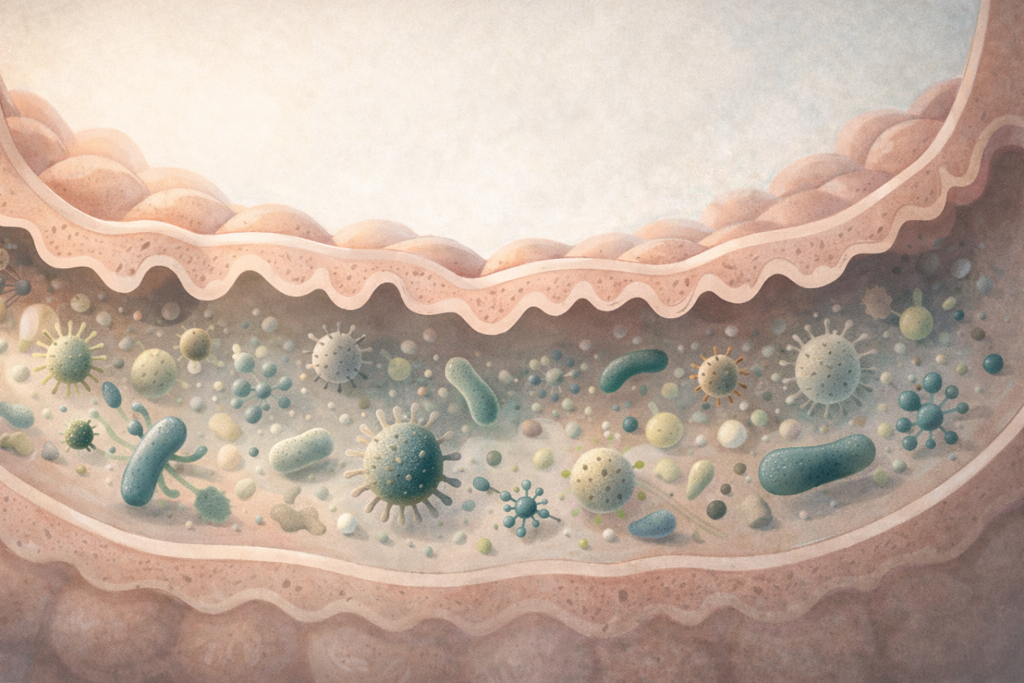
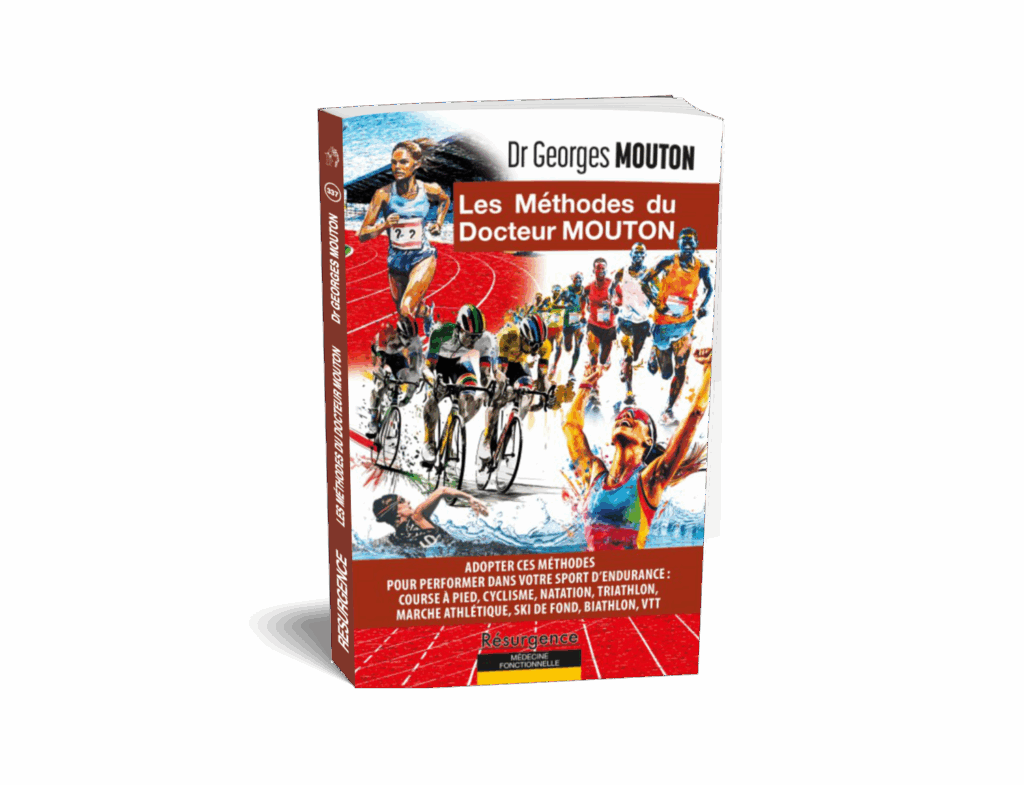

3 commentaires
complètement d accord
leq malades ne savent pas ce qu ils prennent Je suis pour l homéopathie aujourd’hui pas remboursé. J avais signé la pétition pour ne pas la derembourses
j’ai lu le rapport du médecin
C est une guerre chimique qui nous guette.
Le covid a commencé, nous ne savons même pas quel vaccin nous avons eu.
Je suis dépitée, ne crois pas les journalistes qui font l apogée
l apogée des vaccins, Le confinement. Tout était voulu
Comme après une guerre. Il faut reconstruire. Bon nombres d entreprises ont fermé. Restaurants. autres…..
Tout cela sans comprendre que les complotistes avaient raison.