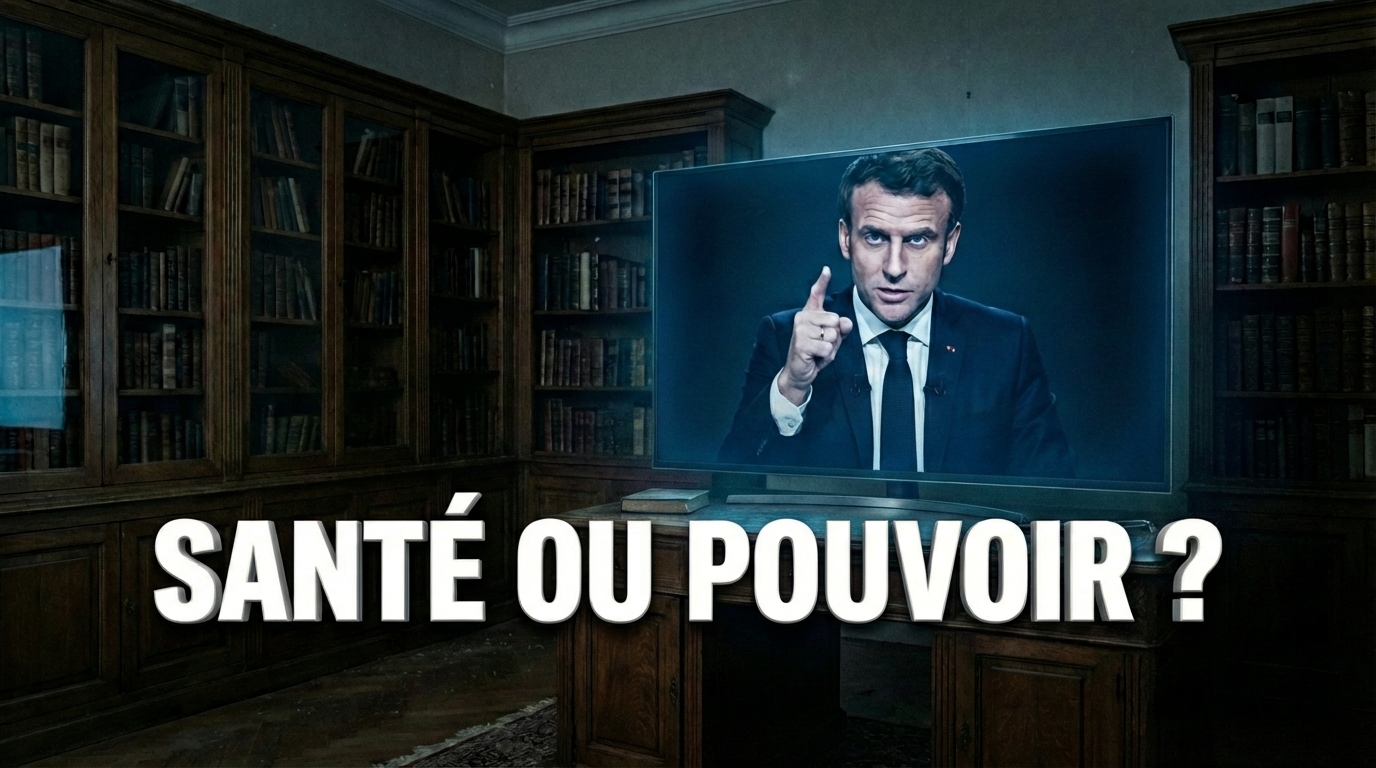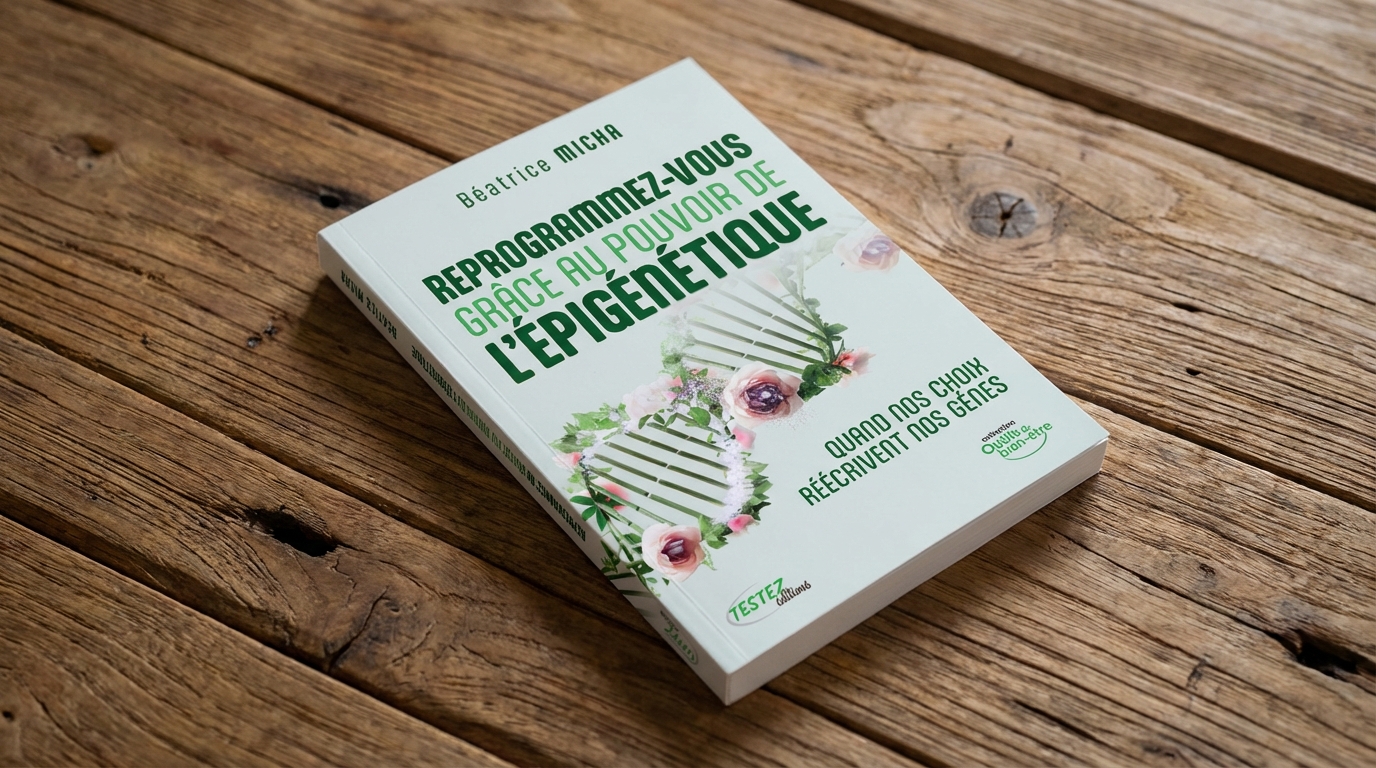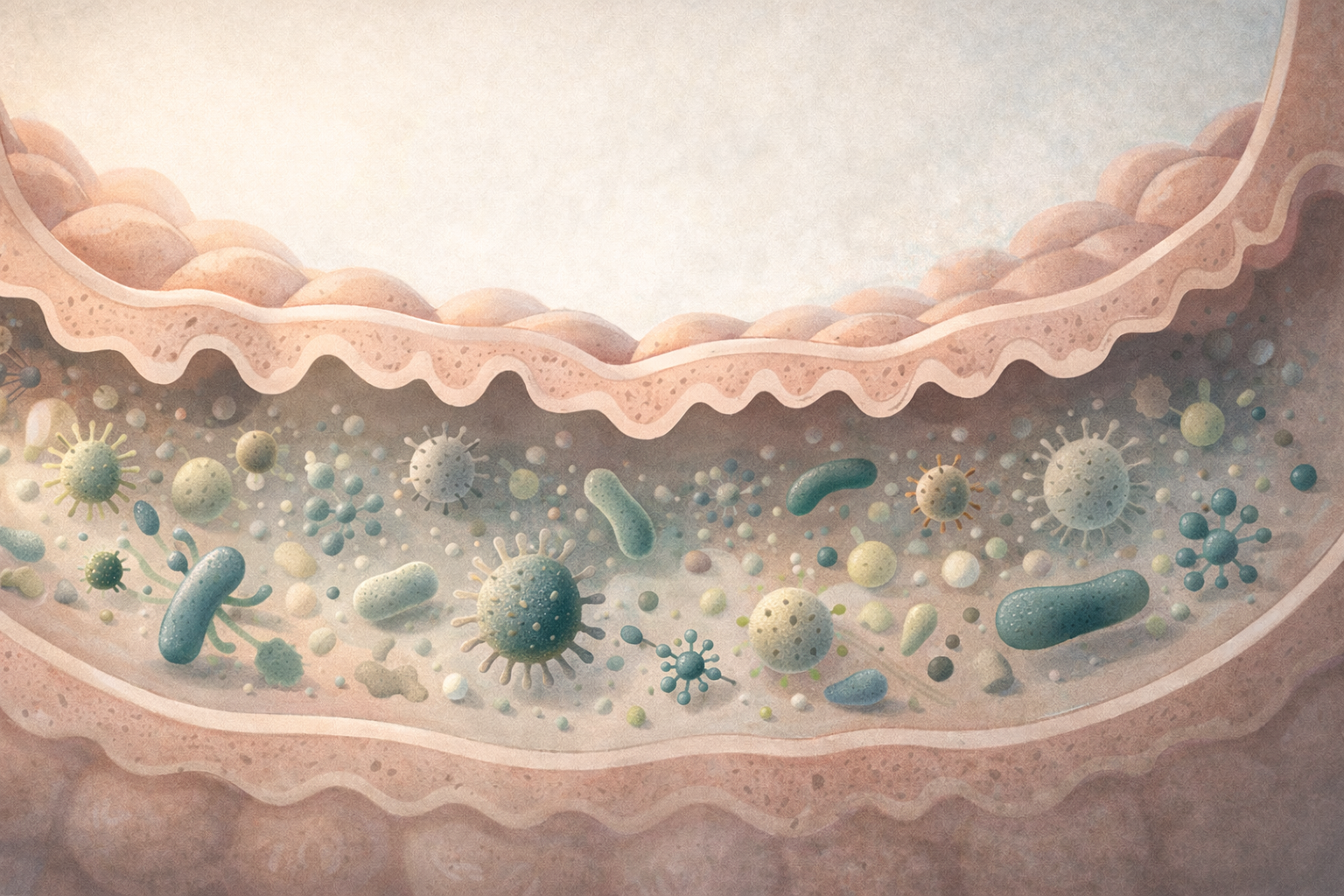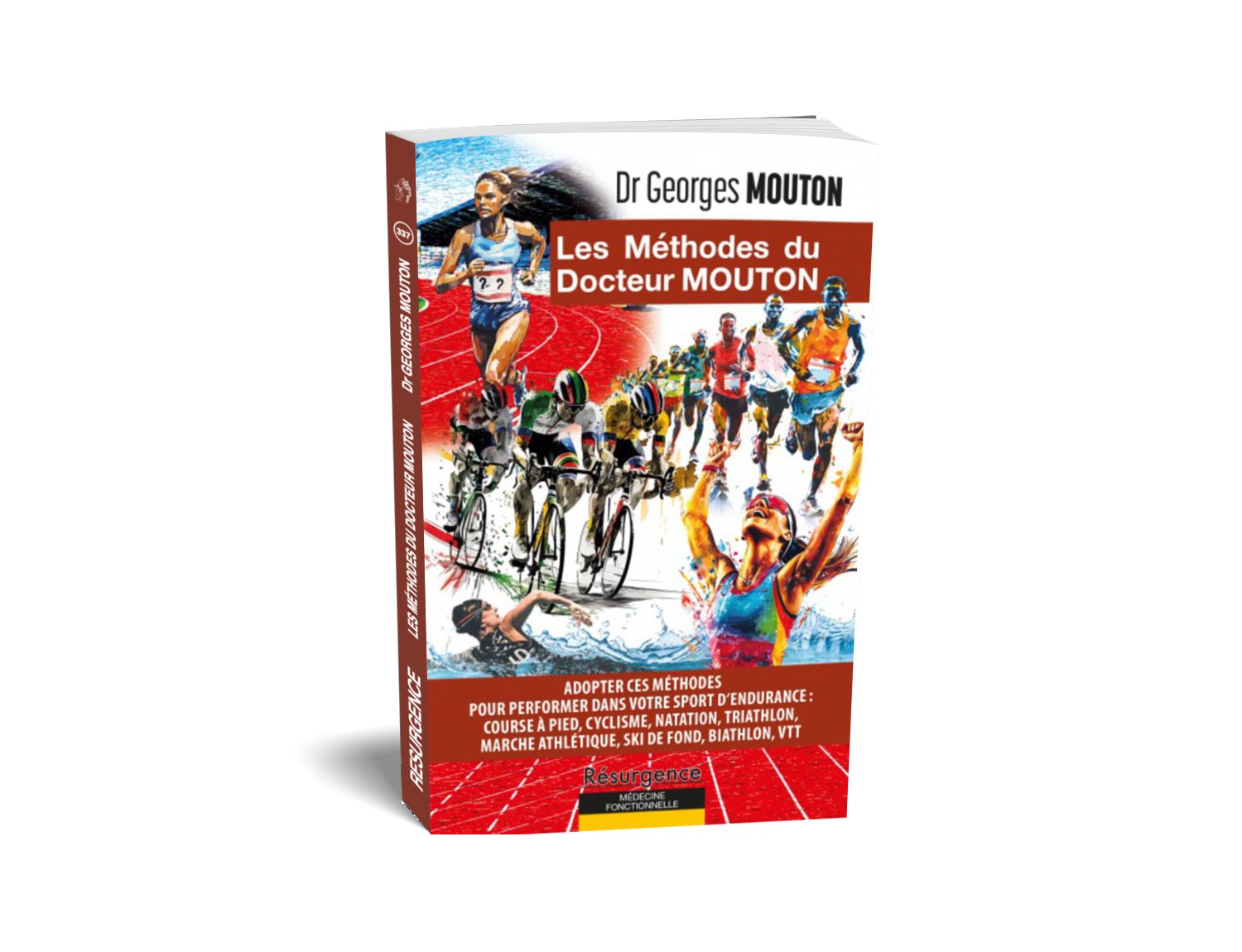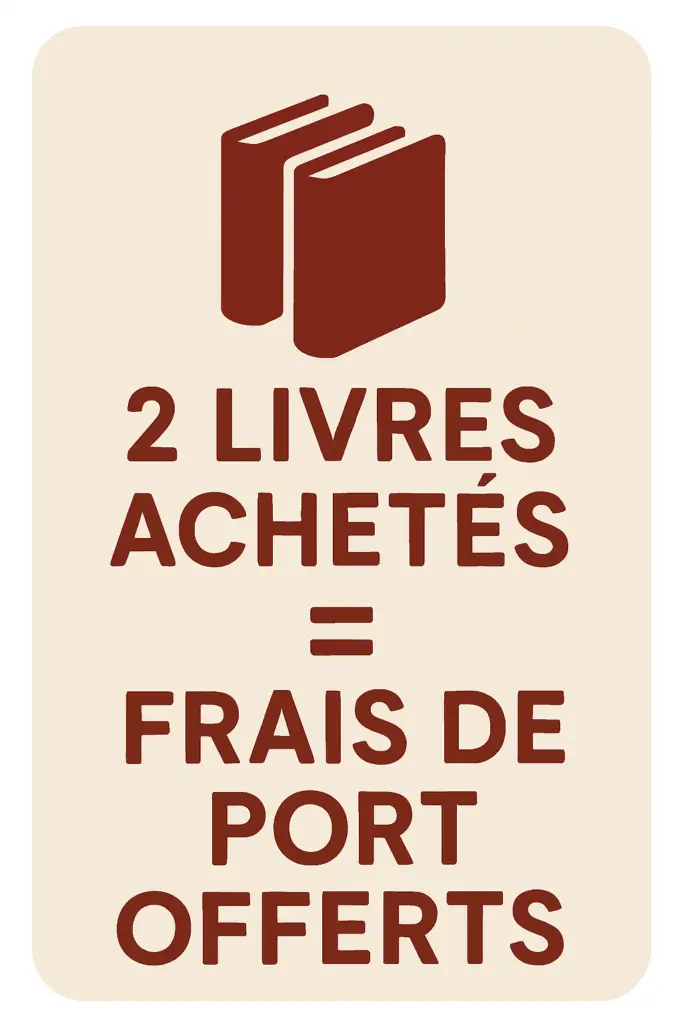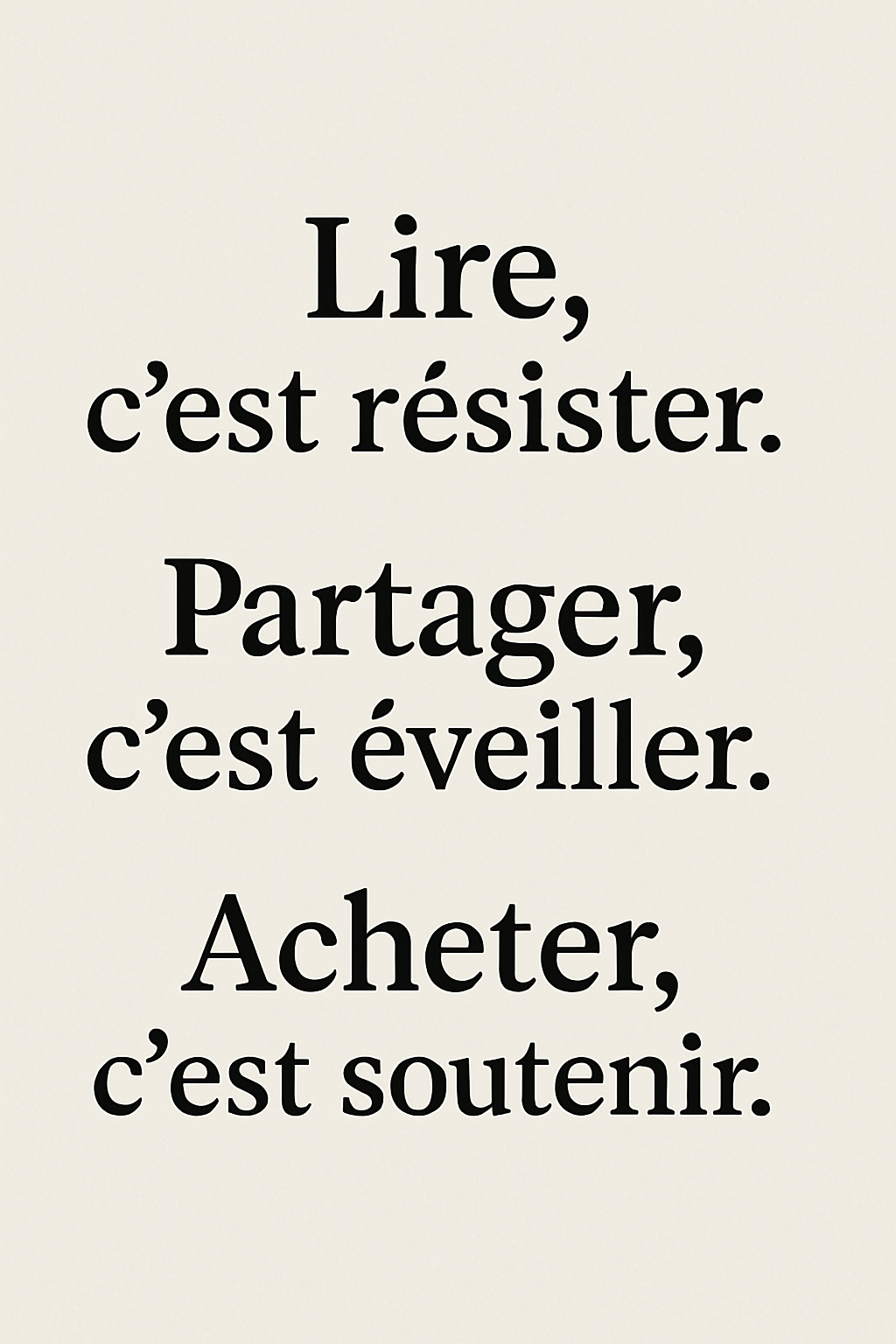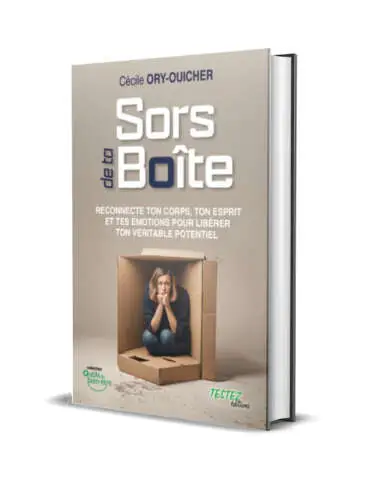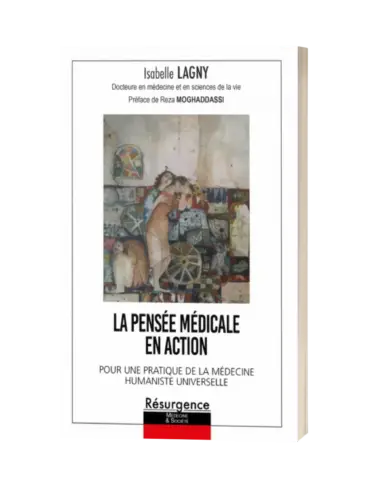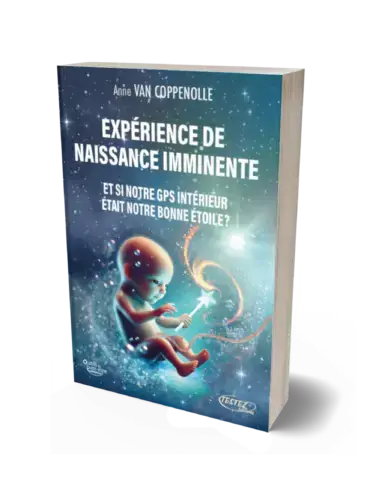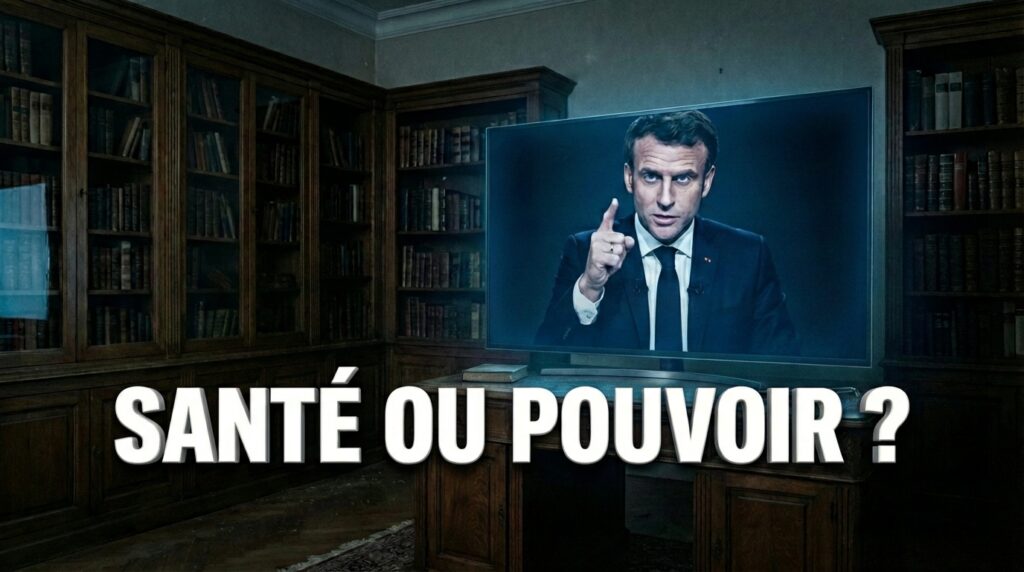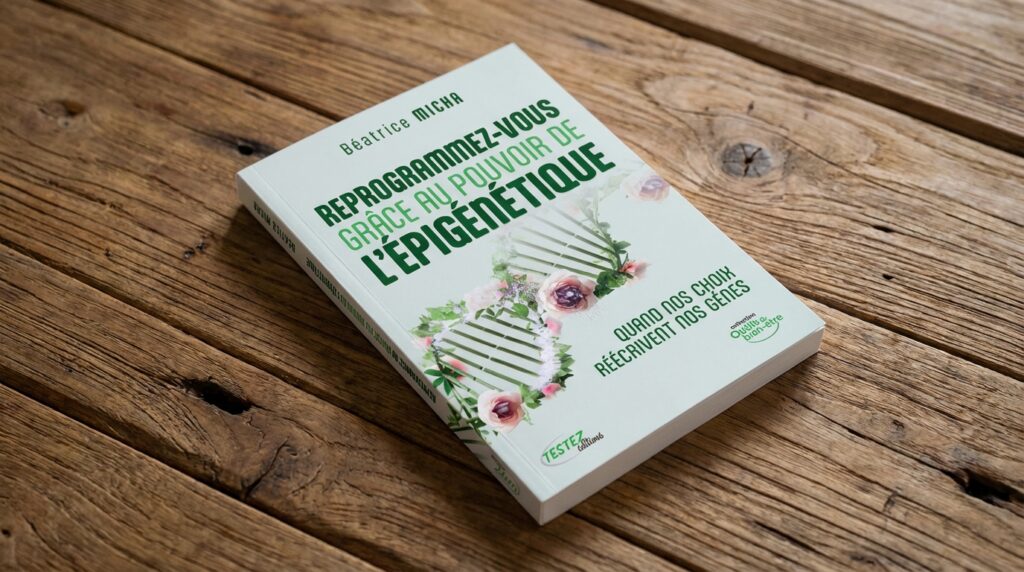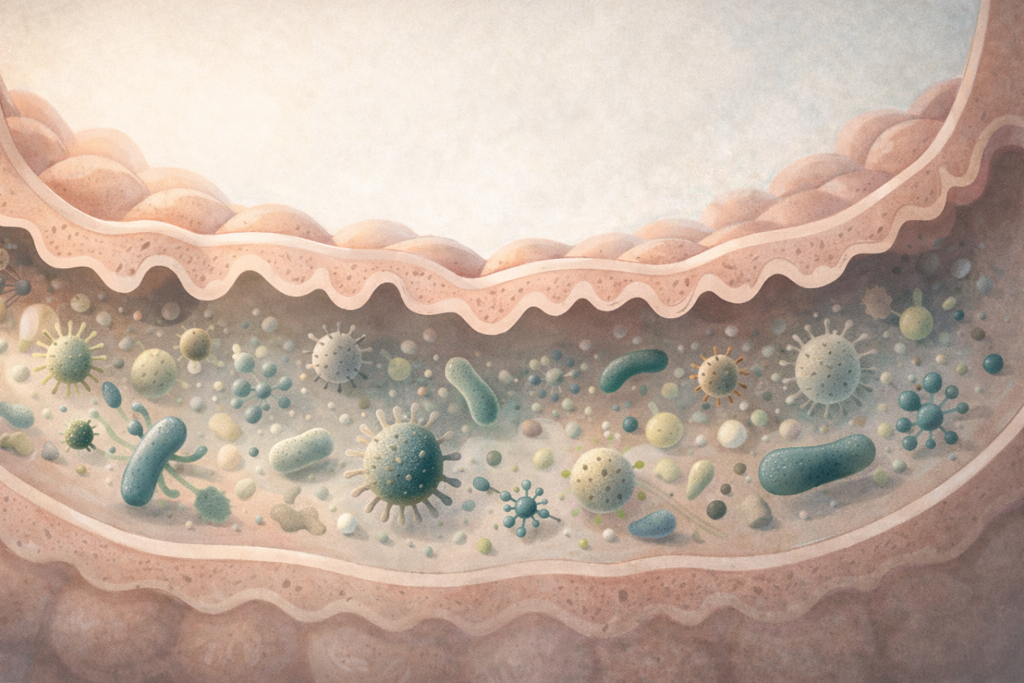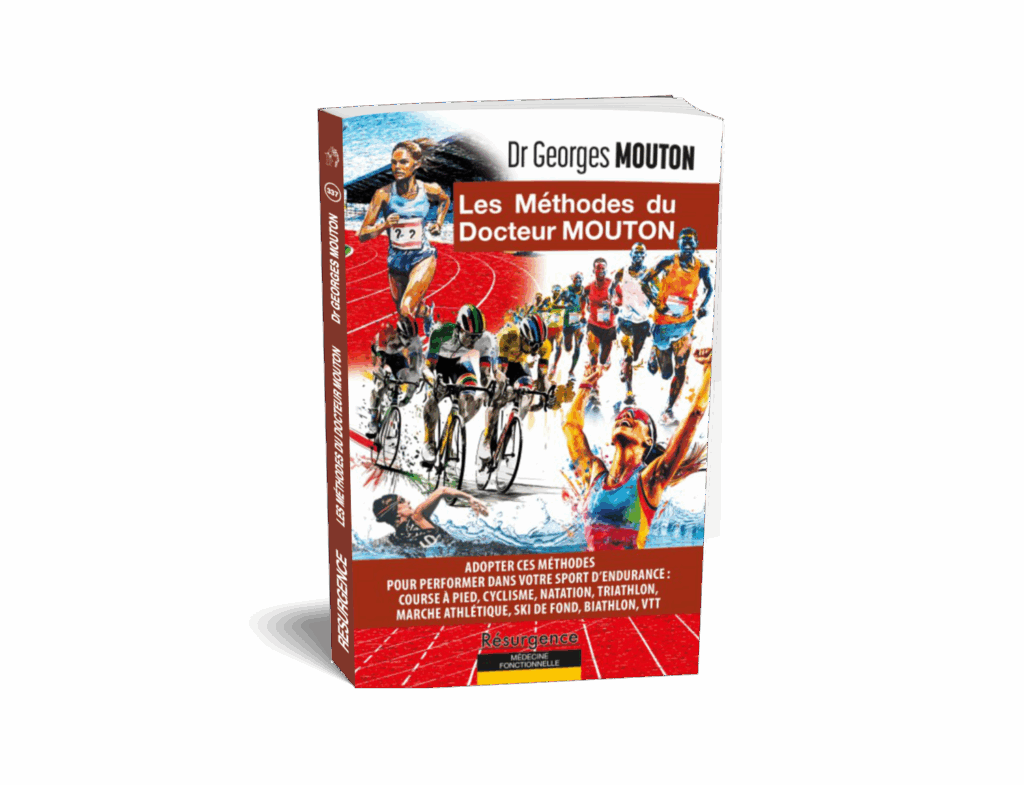En Belgique, la justice Covid entre dans une nouvelle ère.
Après des années de procès, d’accusations et de diffamations médiatiques, des citoyens autrefois désignés comme boucs émissaires se lèvent aujourd’hui pour réclamer des comptes.
L’affaire Gremet-Bonier symbolise ce retournement historique: deux entrepreneurs accusés à tort pendant la pandémie ont été totalement blanchis, avant de lancer une contre-offensive judiciaire contre l’État belge, l’AFMPS et plusieurs grands médias.
Ce qui se joue ici dépasse une simple affaire individuelle. Pour la première fois, des victimes du narratif sanitaire s’appuient sur le droit pour exposer les abus institutionnels et médiatiques commis au nom de la sécurité publique.
C’est un tournant dans le rapport entre le citoyen et le pouvoir: le temps de la peur s’efface, celui de la responsabilité commence.
La justice Covid en Belgique pourrait bien marquer le début d’un rééquilibrage moral, juridique et démocratique, là où la confiance s’était effondrée.
La contre-offensive judiciaire qui secoue la Belgique
Dans le paysage de la justice Covid en Belgique, peu d’affaires auront autant frappé les esprits que celle de Cécile Gremet et Frédéric Bonier. Totalement acquittés après plusieurs années de procédures, ils ont décidé de ne plus subir.
Leur riposte prend la forme d’une série d’actions judiciaires d’une ampleur inédite: IPM, Rossel, la RTBF, l’AFMPS, l’État belge et le Gouverneur du Brabant Wallon sont désormais cités dans leurs plaintes.
Leur objectif?
Obtenir réparation, mais aussi exposer la mécanique du harcèlement médiatique dont ils disent avoir été victimes.
À travers des articles falsifiés, des refus de droit de réponse et des amalgames politiques, ils décrivent un système de dénigrement conçu pour faire taire toute voix discordante pendant la pandémie. Aujourd’hui, ce sont ces mêmes institutions qui doivent rendre des comptes.
Plus encore qu’un procès, leur démarche est une démonstration: la peur a ses limites, la vérité finit toujours par reprendre la parole.
En choisissant de se défendre seuls, sans avocat, Gremet et Bonier rappellent que la justice n’appartient pas aux puissants mais à ceux qui osent s’en emparer.
Leur combat ne concerne plus seulement leur honneur, mais la possibilité, pour tous les citoyens, de retrouver foi dans la loi après le chaos sanitaire.
La justice Covid en Belgique devient ici un champ d’expérience inédit: celui où les victimes d’hier transforment leur blessure en levier de réparation collective. Peut-être est-ce ainsi que renaît la confiance.
Comment la peur médiatique s’est retournée contre ses auteurs

Pendant la pandémie, la peur était devenue un instrument de gouvernement. Chaque jour, les écrans diffusaient des chiffres bruts, des visages masqués, des slogans sanitaires sans nuance. E
n Belgique comme ailleurs, ce climat de sidération a permis d’imposer l’inacceptable: la présomption de culpabilité pour quiconque questionnait la narration officielle.
Cécile Gremet et Frédéric Bonier ont été pris dans ce vortex. Accusés de tromperie, d’escroquerie et même d’idéologie extrémiste, ils ont vu leurs entreprises détruites, leurs proches stigmatisés, leur image ruinée. Les grands médias, au lieu d’enquêter, ont servi d’amplificateurs à la peur.
Le jugement du tribunal a depuis révélé que ces accusations reposaient sur du vent. Mais le mal était fait: leur nom, associé à la suspicion, avait servi de caution à tout un dispositif de contrôle de la parole.
Aujourd’hui, le vent tourne. Ceux qui avaient fait de la peur un outil de légitimité découvrent qu’elle se retourne contre eux. L’opinion se lasse des demi-vérités, les journalistes indépendants gagnent du terrain, et la justice, lentement mais sûrement, commence à redonner sens à la vérité factuelle.
Les médias belges les plus puissants, IPM et Rossel, se retrouvent maintenant à la barre pour répondre de leurs pratiques. Le refus du contradictoire, les rectifications d’articles a posteriori et les accusations sans preuves deviennent autant d’éléments à charge. Le mécanisme de peur qu’ils avaient alimenté menace aujourd’hui leur propre crédibilité.
Dans ce renversement symbolique, la justice Covid en Belgique n’est plus seulement une affaire judiciaire: c’est une leçon politique. Elle rappelle qu’aucun pouvoir médiatique ne peut durablement survivre à la perte de confiance du public.
Combien de temps faudra-t-il encore pour que ceux qui ont façonné la peur rendent enfin des comptes à la vérité?
Transparence, conflits d’intérêts et réécriture du réel
L’affaire Gremet-Bonier agit comme un révélateur: derrière les discours sur la santé publique, c’est tout un système d’intérêts croisés qui se dévoile. Les autorités sanitaires, les grands groupes de presse et certains responsables politiques se sont appuyés mutuellement pour imposer une version unique de la réalité, sans espace pour le doute ni pour la contradiction.
L’un des points les plus graves concerne la RTBF, accusée d’avoir modifié rétroactivement ses articles. Un texte initialement favorable aux tests Medakit, publié en mai 2020, aurait été réécrit après coup pour qualifier ces produits d’« autotests », une catégorie qui n’existait même pas encore sur le marché à cette date.
Cette manipulation sémantique, anodine en apparence, change tout: elle permet de transformer une initiative privée validée par les faits en infraction imaginaire.
Ce glissement du vocabulaire vers la falsification du réel révèle une dérive inquiétante.
Quand les institutions censées informer deviennent juges et parties, la frontière entre vérité et propagande se brouille. Le Conseil de déontologie journalistique a d’abord rejeté la plainte, avant de la reconsidérer une fois révélés les liens politiques d’un de ses membres.
Ces détails, passés sous silence dans les grands médias, illustrent la fragilité du contre-pouvoir médiatique dès qu’il s’agit d’examiner ses propres fautes.
À mesure que ces faits ressurgissent, un constat s’impose: la justice Covid en Belgique ne se résume pas à un procès, mais à une opération de transparence. Ce que Gremet et Bonier exposent, c’est un engrenage où la peur a servi de paravent à des logiques d’influence, de financement et de pouvoir.
La parole du chercheur honnête, du journaliste indépendant ou du simple citoyen s’est perdue dans le bruit des subventions et des carrières.
Peut-être est-il temps de remettre la lumière sur ce que la pandémie a voulu dissimuler: notre droit à la vérité.
Courage civil et liberté d’expression retrouvée

Dans ce contexte saturé de peur et de manipulation, le geste de Cécile Gremet et Frédéric Bonier prend une portée symbolique majeure. Leur choix de se représenter eux-mêmes, sans avocat, face à des institutions puissantes, dépasse la simple stratégie judiciaire. C’est un acte de résistance. Un rappel que la dignité humaine ne se délègue pas, qu’elle se défend.
Ils affirment n’avoir plus confiance dans un système où la vérité se négocie selon les intérêts du moment. Leur posture dérange, parce qu’elle inverse la logique habituelle: au lieu de mendier la justice, ils la convoquent.
Ce retournement du rapport de force révèle une leçon universelle. Il n’est pas nécessaire d’être nombreux pour être légitime, il suffit d’être aligné avec le vrai.
Ce combat a aussi une dimension collective. En ouvrant la voie à d’autres plaintes, ils posent un précédent: désormais, chaque citoyen lésé par les décisions arbitraires ou les campagnes médiatiques de la période Covid peut envisager une action en justice.
Ce mouvement pourrait devenir une vague de fond. Il rend concret le principe que la justice Covid en Belgique n’appartient pas qu’aux juges, mais à tous ceux qui ont refusé la peur.
Frédéric Bonier l’a résumé avec une lucidité brute: « Ils nous ont foutu la vie en l’air pendant cinq ans. Ma mère en est morte. J’irai jusqu’au bout. »
Derrière cette phrase, ce n’est pas la vengeance qui parle, mais la volonté de restaurer une vérité partagée.
C’est le langage d’une liberté retrouvée, celle qui ne demande plus la permission de parler.
L’histoire de Gremet et Bonier rappelle que la justice ne se limite pas aux tribunaux. Elle se manifeste chaque fois qu’un être humain choisit le courage plutôt que la soumission. Chaque fois qu’une voix se relève dans le vacarme du mensonge.
C’est ainsi que la peur finit par perdre son pouvoir.
Vers une Europe plus consciente et plus juste
L’affaire Gremet-Bonier dépasse les frontières belges. Ce qu’elle révèle concerne l’ensemble des démocraties européennes : la difficulté d’admettre ses erreurs, la lenteur à corriger les dérives, et le besoin urgent de restaurer la confiance entre institutions et citoyens. Dans cette crise de sens, la justice Covid en Belgique apparaît comme un miroir tendu à tout un continent.
L’Europe a bâti son identité sur la transparence, les droits fondamentaux et la raison critique. Or, la gestion de la pandémie a mis à nu les failles de ce modèle. La peur a parfois remplacé la réflexion, la censure s’est déguisée en prudence, et la compassion a cédé la place à la conformité. En osant rouvrir les dossiers passés, la Belgique rappelle qu’aucune société ne peut évoluer sans examen de conscience collectif.
Ce réveil judiciaire porte en germe une promesse : celle d’une Europe plus lucide, capable d’apprendre de ses excès plutôt que de les justifier. Le courage de quelques citoyens peut suffire à réactiver les valeurs fondatrices du Vieux Continent : liberté, vérité et responsabilité.
C’est peut-être dans cette modestie du courage que se prépare la véritable renaissance européenne.
La justice sur le Covid en Belgique n’est pas seulement une page d’histoire, c’est un signal. Elle nous rappelle que la démocratie ne se défend pas dans les discours, mais dans les actes.
Et si cette vigilance retrouvée devenait le ferment d’une Europe plus consciente, plus digne, et enfin fidèle à sa promesse initiale : protéger les peuples, et non les puissances?
Une vérité qui demande notre participation
L’histoire de Gremet et Bonier ne se termine pas avec leur victoire judiciaire. Elle ouvre une question collective : que ferons-nous, chacun à notre échelle, de ce rétablissement du vrai? Car la justice après Covid en Belgique ne réparera durablement les torts passés que si la société tout entière s’en empare.
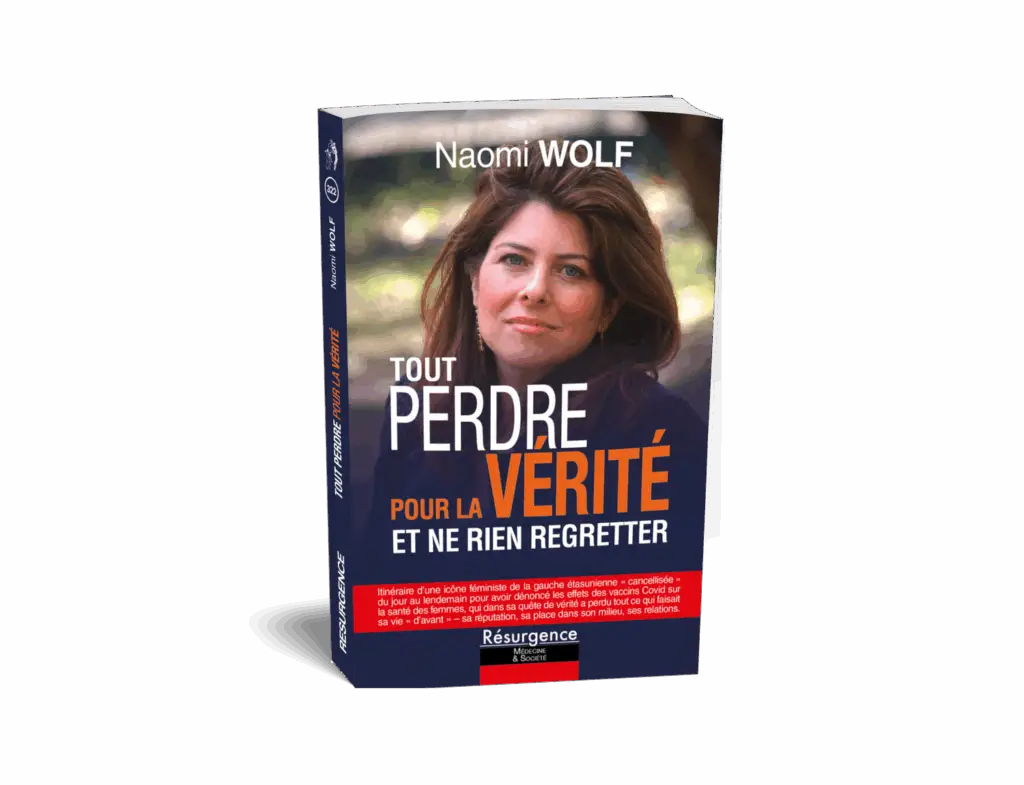
Leur combat invite à reprendre part au débat public, à refuser l’amnésie médiatique et à exiger la transparence de ceux qui ont façonné la peur. La justice ne doit pas être un spectacle occasionnel, mais une vigilance quotidienne. C’est là que s’exerce la liberté : dans la capacité à questionner, à écouter, à discerner sans haine.
L’affaire Gremet-Bonier nous rappelle qu’il n’y a pas de vérité absolue, mais qu’il existe une exigence absolue de sincérité. Elle nous rappelle aussi que le courage commence souvent par un simple mot : non. Non au mensonge, non à la peur, non à la résignation.
Le reste, c’est une reconstruction lente, mais possible. Parce qu’à chaque fois qu’un citoyen choisit de regarder la réalité en face, un pas est fait vers la guérison de notre démocratie.
La vérité, aujourd’hui, a besoin de témoins.
À lire pour aller plus loin
Le livre « Tout perdre pour la vérité » de Naomi Wolf, publié aux Editions marco pietteur, prolonge ce questionnement essentiel : que reste-t-il de la liberté quand la peur gouverne ? L’autrice y démonte avec précision les mécanismes de manipulation qui ont envahi nos institutions pendant la pandémie et appelle chacun à reconquérir sa souveraineté intérieure.
Ce livre nous rappelle que chacun peut résister au mensonge par la clarté et le courage.
Et vous, qu’est-ce qui vous aide à rester fidèle à la vérité?
Partagez votre regard, votre expérience, vos mots.
Chaque témoignage compte pour nourrir une conscience collective éveillée.